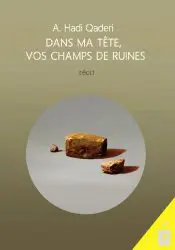« Après quelques heures de vol, ils atterrirent à Amsterdam. Ils étaient éblouis par tout ce qu’ils voyaient […]. Au bout de huit heures, ils prirent un autre avion, cette fois en direction d’un monde totalement inconnu. Abdulhadi, avec son bagage de vie et ses deux petites années d’école primaire, s’envolait pour le Canada. » En 1994, l’Afghan Abdulhadi Qaderi en exil au Pakistan arrive au Québec. Depuis, il a non seulement appris le français, mais il est devenu titulaire d’une maîtrise en sciences politiques, dont le mémoire portait sur la révolution afghane. Aujourd’hui doctorant en sciences politiques à l’UQAM, objet de son enseignement actuel au Collège de Maisonneuve, il propose son autobiographie Dans ma tête, vos champs de ruines.
« Le 5 juin 1970 est né un enfant dans une famille pauvre d’une région pauvre de l’Afghanistan, un des pays les plus pauvres de la planète. […] Personne n’aurait pu prédire son parcours. Seule évidence : la misère matérielle. » Parlant de lui à la troisième personne, devenant ainsi le protagoniste de sa propre épopée, Abdulhadi Qaderi raconte l’histoire de ce coin du monde où importent plus que tout les allégeances familiales, tribales et claniques, où règnent un code d’honneur précis, une domination patriarcale et des codes religieux contraignants. Sa famille appartient à la minorité ismaélienne de l’Islam chiite, considérée comme « non musulmane » et de fait, persécutée.
Il faut se rappeler que de 1979 à 1989, l’armée de l’ex-URSS a ravagé l’Afghanistan avant de se retirer, poursuivant une lutte féroce contre le pouvoir des moudjahidine ou guerriers saints. En plus des Russes, plusieurs puissances internationales ont combattu la résistance locale sur ce même territoire, menant des guerres sanglantes, souvent désespérées et fréquemment inutiles, dont les États-Unis, l’Arabie saoudite et le Pakistan.
Dans ma tête, vos champs de ruines permet de retracer les grandes lignes de ces conflits complexes, tels que vécus de l’intérieur par un enfant du pays, qui en raconte les impacts sur la société afghane en général et sur sa famille en particulier. Le récit n’est pas facile, autant dans son propos que dans sa facture. Deux cartes géographiques aident autant le lecteur à visualiser la géographie du pays et de ses voisins frontaliers qu’à situer les nombreux peuples qui l’habitent, Tadjiks, Pachtounes ou Ouzbeks. L’arbre généalogique des ancêtres de Qaderi, Qader Baba et Muhammad-Beg, aide à mieux saisir les subtilités des alliances, mésalliances ou désalliances familiales.
Même « si le départ fut très déchirant [car] laisser sa famille et sa tribu était d’une difficulté innommable », Abdulhadi Qaderi a voulu partager les moments forts, qu’ils soient doux, heureux ou difficiles, de son séjour au pays de son enfance.
ESPACE PUBLICITAIRE
DERNIERS NUMÉROS
DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE
Loading...