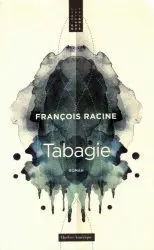La critique anglo-saxonne recourt à l’expression « lad lit » pour qualifier l’équivalent masculin de la « chick lit », bien connue au Québec. Les publications du genre ont ceci en commun qu’elles gravitent généralement autour de mâles amitiés, de bamboches citadines ponctuées de séances de sexe sans lendemain, bref, de personnages polygames assez minces qui boivent sec et pissent loin. Sans se résumer à cette dimension superficielle tout aussi superficiellement résumée, disons que Tabagie, le deuxième roman de François Racine en autant d’années, se complaît abondamment dans ces sujets-refuges auxquels semblent puiser plus ou moins heureusement chaque génération de jeunes écrivains comme s’il s’agissait d’un rite de passage.
Après le roman de la route Truculence vient donc celui de la ville, de Montréal et de son quartier Côte-des-Neiges, où la tabagie du titre a pignon sur rue. Léo Rivière y travaille à la petite semaine en attendant de terminer (de commencer) un mémoire sur Proust, si ce n’est sur Céline. L’idée de camper l’action dans ce laboratoire social, carrefour des sociabilités humaines, représente un point de départ intéressant. Mais au réalisme du portrait de société, l’auteur préfère le pittoresque d’une clientèle de déséquilibrés. La chose fait d’abord sourire. Après cent pages, on est en droit de se demander s’il y a un seul lecteur sain d’esprit dans le grand Montréal de Racine. La piste de la tabagie condamnée, celle des frasques sexuelles et des exploits éthyliques mise de côté, que reste-t-il ?
Une captivante partie de pinball amoureux entre Rivière et Natalia, « Québécroate » étourdie comme une toupie, une femme au passé trouble qui l’entraîne avec elle dans le tourbillon de sa perte. Les moments les plus forts de cette relation destructrice rappellent d’ailleurs agréablement Ces spectres agités et le Louis Hamelin des débuts, ce qui n’est pas peu dire. C’est probablement là l’aspect le plus réussi du roman, le filon le mieux exploité jusqu’à la finale explosive qui laisse pantois. Racine renoue avec son style reconnaissable entre tous, une écriture oralisante, une « oraliture » qu’il expérimente en bon disciple de Céline. La demi-mesure n’est cependant pas son fort. Trop envahissants, trop gratuits, la moitié des jeux de mots racolent en éclipsant les plus travaillés. Résultat ? Une demi-réussite.
ESPACE PUBLICITAIRE
DERNIERS NUMÉROS
DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE
Loading...