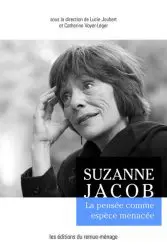Dans un texte qu’elle signe au début de l’ouvrage collectif, Suzanne Jacob montre le foisonnement de son écriture ainsi que la singularité et la richesse de sa pensée. Son refus de la linéarité et l’originalité de sa saisie du monde.
Vous êtes la personne la plus négative que je n’ai jamais rencontrée, lui a décoché la directrice d’un institut médical, à la suite d’un fait que Suzanne Jacob nomme « l’événement de ma mort récupérée ». Nous voilà, dans l’instant, témoins de l’univers de cette femme-orchestre – romancière, nouvelliste, poète, essayiste, scénariste, chroniqueuse, sans oublier l’artiste visuelle (esquissée par Valérie Mandia) et l’autrice-compositrice-interprète (par Jeanne Mathieu-Lessard), cette dernière reprenant la formule qu’utilisait Jean Royer, en 1987 : « [I]l y a deux Suzanne Jacob, celle qui chante et celle qui écrit ».
Dans l’introduction de Suzanne Jacob. La pensée comme espèce menacée, Lucie Joubert le note bien. La qualité, l’importance et la puissance de l’œuvre de Jacob ne trouvent qu’un écho timide dans l’espace critique. L’ouvrage, placé sous la direction de Lucie Joubert et de Catherine Voyer-Léger, se propose de pallier ce manque, ce qu’il fait très bien.
Lieu de convergence d’idées et de réflexions, une œuvre collective porte d’évidence ses forces et ses faiblesses. La qualité et la portée des textes varient certes, cependant que compensées par la pluralité des points de vue. Pour bien apprécier l’analyse de l’écriture jacobienne, ses multiples stratégies – dont les métaphores incongrues, les postures fausses-naïves, la prosopopée (prêter la parole aux choses inanimées, aux morts ou aux absents) et autres parataxes –, mieux vaut avoir une certaine connaissance de son œuvre. Si l’on veut prendre la mesure de ses entrechats sémantiques et autres subtilités de son art, savamment commentés par les onze autrices, il n’est pas négligeable de voir ou de revoir certains textes. J’en ai profité pour relire son roman L’obéissance, et je me rallie à Alexandrine Agostini qui le qualifie de « première fulgurance » dans sa lettre amoureuse à Suzanne Jacob.
Dans ce composé analytique, on comprend que l’imaginaire, cible de l’obsolescence programmée, fout le camp. Son état de délabrement, appréhendé par Jacob, angoisse. Mais l’humour fin de l’écrivaine prend par la main et accompagne la gravité de son regard sur le monde. Nous sommes devant une écriture qui, précise Lucie Joubert, se sert de l’humour, rallie l’ironie et flirte avec la satire. « On prend l’air, dit un homme en s’asseyant. On vous le rendra, dit Flore. » Ainsi parlent ses personnages, surtout féminins, dont le sens de la répartie plaît à l’esprit. Au fil des analyses, tantôt d’un roman, d’une nouvelle, tantôt d’un scénario, d’une chanson, chaque autrice explore l’imaginaire de Jacob, où la révolte contre l’ordre et la loi côtoie la quête d’autonomie des personnages féminins. La transgression des tabous aussi, celui du langage au premier chef, « cette norme qui dicte comment dire », comme elle le pointe dans son essai La bulle d’encre(2001).
« Je n’ai pas envie d’être incarcérée dans une image », confiait-elle dans un film qui lui est consacré (Le temps passant, André Romus, 1984). À sa façon, chaque texte du livre s’emploie à le démontrer. S’il y a un léger bémol, il porte sur l’usage du vocable « agentivité » à plusieurs reprises : « quitter la demeure devient preuve d’agentivité » ; « le regard, la parole et l’action, trois vecteurs de l’agentivité événementielle » ; « [parvenir] à un certain type d’agentivité ». Ce mot-concept est un dépresseur littéraire, et c’est peu dire du mal que j’en pense. Laid, froid, désespérément indolore et incolore. Inutile. Sans explications sisyphéennes, que dit « agentivité » que pouvoir ou puissance, souveraineté ou autonomie n’expriment pas déjà ? Parfois, la simplicité a bien meilleur goût.
Tiens. Qu’en penserait Suzanne Jacob ? Que laisserait percer son sourire en coin ? Nous l’ignorons. Une certitude toutefois, la plongée dans son œuvre nous assure que sa pensée, complexe, délicate et subtile, n’est en rien menacée.