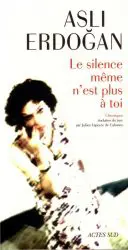L’écrivaine et la mort
Plongée dans une nuit sans fin où l’aube, la lumière, la chaleur sont interdites, l’ancienne physicienne turque Aslı Erdoğan a préféré la lutte à l’exil, et porte depuis une vingtaine d’années l’écriture tel un bouclier contre la barbarie.
Destin plutôt qu’acte de volonté, elle a choisi son camp, celui de ceux qui souffrent, et s’est rangée aux côtés d’eux, Kurdes ou Arméniens, mères du samedi1, hommes, femmes et enfants blessés, torturés, tués, à Cizre, à Kobané ou à Istanbul.
Dans « Au pied d’un mur », première de 29 chroniques bien lovées dans une prose poétique soutenue, l’écrivaine prise sous le feu des insurgés, des tireurs embusqués et des forces armées turques sur l’une des grandes avenues d’Istanbul s’écrase au sol surordre d’un policier en civil : « Baisse ta tête, ma sœur ! » Ce 15 juillet 2016, un coup d’État, un autre, jette sa noirceur sur la ville, les corps et les cœurs, alors que se déroule une guerre qui loge dans ses confins les plus sauvages, et à laquelle Aslı Erdoğan ne trouve aucun équivalent, car la réalité déborde d’elle-même.
Ses chroniques, parues dans un journal prokurde, lui ont valu 136 jours d’incarcération à la prison de Bakırköy, à Istanbul. Elles disent la barbarie de la guerre. Le drapeau blanc qu’on assassine. L’espace des ambulances qu’on brûle. L’hôpital de campagne troué de balles. Elles cherchent avec obsession les mots capables de saisir l’inracontable. Les mots secs et nus. Ces mots pétris d’ombre et de silence, en tous les cas, jamais suffisants ou satisfaisants pour crier la souffrance des maux et des morts. Il est pourtant ce mot lumineux qui refuse de se taire. Aslı Erdoğan le fait vibrer, résonner, tente par tous ses moyens littéraires de l’arracher à ses fers. La liberté, au nom de laquelle combien d’universitaires, de journalistes, d’artistes, d’inconnus l’ont perdue en cette décennie noire qui étend son voile opaque sur la Turquie. Déjà en 2010, les touristes les plus sensibles qui se pressaient sur la place Taksim à Istanbul sentaient l’étau dictatorial se resserrer et les poussées de l’islam politique. Dans sa chronique « Le silence même n’est plus à toi », elle écrit : « […] la Turquie des années 2010 a jeté en prison quatre universitaires, sur ‘ordre venu d’en haut’ ! Pour trouver semblables faits dans la longue histoire de l’oppression, il faut remonter à la période nazie, à la Pologne occupée ! »
La banalité du mal, telle que l’a décrite Hannah Arendt, se clone sous la plume d’Erdoğan, et sur sa terre mythique, où l’Asie rencontre l’Europe, l’horreur du crime devient ordinaire, affreusement ordinaire. Dans cette Byzance, devenue Constantinople, puis Istanbul, si moderne avec ses quartiers branchés, ses restos bondés, sa vie intellectuelle et artistique, l’oxygène démocratique se raréfie, et le pays est maintenant devenu la prison mondiale des journalistes. L’an dernier, sous la férule de Recep Tayyip Erdoğan (aucun lien de parenté entre l’écrivaine et le président turc), 170 journaux, magazines, radios et télés ont été fermés en deux mois, se désespère la militante armée de son seul désir de dire ce que le pouvoir cherche à taire à tout prix.
À bout de souffle, à bout de nerfs, presque à bout d’espoir, Aslı Erdoğan réaffirme pourtant sa foi en cette « flamme vacillante d’une bougie qui brûle toujours dans le cœur au point de bascule ». De passage à Paris à la fin du mois de septembre 2017, en liberté provisoire, elle apparaît sur le plateau de La Grande Librairie, fragile mais déterminée, « brûlant du feu inextinguible de la résistance ». On sait dès lors que son verbe ne baissera pas les bras. À la reprise de son procès à l’automne 2017, devant ses juges et leur accusation de « propagande terroriste », passible d’une condamnation à perpétuité, elle continuera de se tenir debout avec pour unique défense celle de la littérature qui raconte les victimes, les femmes violées, les Kurdes qui se battent pour leur autonomie, les Arméniens qui réclament justice, les homosexuels traqués. « Cela, ce n’est pas un crime », plaide-t-elle.
Malgré la dureté de l’existence, malgré la cruauté de son parcours, la femme de haute passion et de haute tension se dit heureuse d’avoir raté ses suicides à 10 ans et à 22 ans. La littérature qui ne se marchande pas, que l’on doit apprivoiser mot à mot, cette littérature qui refuse la servitude et croit en l’immortalité de la parole tient depuis ce temps l’écrivaine à distance de la mort.
1. Depuis 1995, les mères de détenus morts ou disparus alors qu’ils étaient emprisonnés ou interrogés par la police se rassemblent le samedi à Istanbul, et exigent justice. En avril 2017, elles tenaient leur 630e rassemblement, la plus longue désobéissance civile du pays.
ESPACE PUBLICITAIRE
DERNIERS NUMÉROS
DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE
Loading...