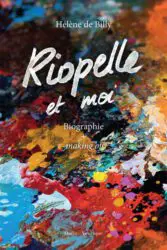Cependant, il a connu de solides rapports d’affaires pendant toute sa carrière de peintre, par exemple avec les galéristes Georges Duthuit, Pierre Schneider puis le prestigieux Aimé Maeght devenus diffuseurs de l’œuvre et protecteurs de l’artiste. Des amitiés durables malgré les problèmes concrets qui se présentaient et, plus étonnant, des amitiés féminines qui ont résisté aux séparations. Homme attachant, disent ceux qui l’ont connu, séduisant, d’une beauté gitane en sa jeunesse, parfois exaspérant par ses changements de projets, le rythme trépidant de vie qu’il imposait autour de lui. Il lui fallait des partenaires à sa taille, en affaires comme en amour. Il les a trouvés.
Ultimement et d’abord, il est le créateur d’un œuvre considérable – il faut convoquer les superlatifs pour parler de Riopelle ! – estimée à 6 000 réalisations. Certes, tout n’y est pas chef-d’œuvre. Dans les dernières années, les oies s’y reproduisent avec une abondance difficile à suivre. Certaines toiles de grand format paraissent ébauchées seulement, voire bâclées (exigences du succès ?). L’Hommage à Rosa Luxemburg a les faveurs du public mais, dans l’exposition conjointe avec les œuvres de Joan Mitchell (par exemple au Musée national des beaux-arts du Québec, à l’hiver 2018) que Riopelle semble avoir tenté de reléguer un peu dans l’ombre, Mitchell se compare avantageusement avec son compagnon, en ampleur, en intensité et en émotion. À cette époque, Joan est malade et elle présente là son adieu à la vie. Devant les meilleures œuvres de Riopelle de ces années (par exemple L’étang – Hommage à Grey Owl) nous saisit un vertige d’espace et de violence causé par la proximité d’une nature inviolée. Libre à chacun de choisir son Riopelle, mais il y a de bonnes chances de le rencontrer dans les triptyques des années 1950, qu’il exécutait à la spatule, où se conjuguent le raffinement et l’épaisseur des couleurs avec une puissance que l’on peut dire monumentale et qui impose l’impression du sacré.
L’ouvrage d’Hélène de Billy retrace, ou reconstitue parfois, en détail la chronologie de l’artiste. Il veut se faire une place à Paris dans les années 1940, dominées par ses contacts avec André Breton. Riopelle est séduit et il intéresse, mais il n’est pas homme à se soumettre longtemps à une discipline de groupe, fût-ce celui des surréalistes. Il fait des rencontres marquantes pour toute sa vie : Artaud, Beckett, Giacometti. Il revient à Montréal à l’époque du Refus global, mais quelle incompatibilité plus radicale entre le fougueux, dionysiaque Riopelle, un peu arriviste, à qui tout réussit, et le solitaire, austère, besogneux et peut-être un peu envieux Borduas ?
La rencontre avec Joan Mitchell a lieu dans « les turbulentes années 1950 ». Époque fertile aussi, voire explosion, pour la création. À Paris, une lutte se livre dans le milieu pictural entre les abstraits français et les Américains, qui prennent l’avantage. Parmi eux, Pollock manifestement influence Riopelle. Celui-ci se livre à un « vagabondage spirituel », à l’alcool, aux équipées folles en auto dont il eut toute sa vie la passion, aux dépenses sans frein, profitant du succès mondial de ses œuvres. Ce qui n’exclut pas des périodes de dépression, de hantise de la mort, « immense personnalité » se sentant alors menacée par la peur du vide. Mais quand il revient s’établir au Québec après divers allers-retours à Paris, il retrouve des ambiances qu’il aime, la chasse, les animaux, le Grand Nord. À Joan qui fut « la femme de sa vie », mais qui s’est sentie finalement délaissée, comme une « louve blessée » (elle meurt en octobre 1992), succèdent Hollis Jeffcoat, puis Huguette Vachon. Quand Riopelle atteint 61 ans, sa santé, constamment mise à l’épreuve, est défaillante. À l’été 1995, il s’installe à l’Isle-aux-Grues « dans un vieux manoir, face à la mer et attend la fin du monde ». La sienne survient le 12 mars 2002.
Hélène de Billy termine ainsi une volumineuse biographie qu’elle a nourrie de souvenirs, de rencontres personnelles, d’anecdotes, de jugements. Fort bien, ce choix enrichit l’ouvrage dans ses meilleures pages, écrites avec vivacité et mouvement. Mais l’excès nuit ! Le récit progresse en faisant alterner des chapitres sur Riopelle et des « Souvenirs de coulisses » où elle narre sa propre vie. Choix risqué et malheureux car le lecteur perd à l’occasion Riopelle lorsque le récit glisse vers des commentaires parasites et anecdotiques que guette la surcharge, de Billy ayant oublié parfois qu’elle fait la biographie du peintre, et non pas la sienne. Il est regrettable que – déjà dans le titre – elle se soit donné tant de place.
Au-delà des mérites et des surcharges de l’ouvrage, quelle impression finale conserve le lecteur de Riopelle et moi. Biographie, sinon la tristesse de voir un immense créateur connu dans le monde entier devenir en ses dernières années le clochard pathétique et cynique que révèlent les photos, comme « la caricature de lui-même », en train de faire son ultime naufrage ?