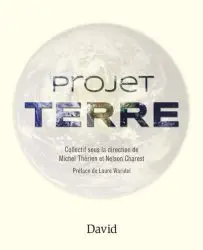La poésie peut-elle aider à sauver la terre ? Qui sait ? Au pire, elle ne nuira pas, au mieux, elle suscitera des réactions personnelles qui, ensuite, appuieront les mouvements écologistes. C’est cet espoir qui a incité les responsables de l’édition de la présente parution à faire appel aux poètes pour le Projet Terre.
Divisé en cinq parties, ce recueil aborde différentes facettes de la problématique que présentent les directeurs dans la préface.
« La terre de nos racines » ouvre la réflexion : « Je suis une animale sociale en déambule / une voix qui avance à travers le fleuve du social », affirme Chloé Sainte-Marie, appuyée par Zachary Richard qui rappelle l’ouragan Rita, Jean Marc Dalpé avec ses « Trois portraits par temps de peste » (le titre dit tout), et Daniel Lavoie qui s’interroge sur les façons de « s’en sortir ».
Les parties suivantes proposent un cheminement qui semble fonctionner par soubresauts : « Les mots de la terre », qu’il faut aussi lire comme « les maux », s’opposent à « La terre infinie » que « les lieux de la terre » viennent « circonscrire », tandis que « La terre à l’agonie » hurle son inquiétude au sujet de ces « lieux » dont nous n’avons pas pris soin.
« La terre est ma chair » de Georgette LeBlanc évoque « à ce qui demeure / à ce qui fleurit / à ce qui récolte / ou repose / en terre » de Martine Audet. Ainsi en est-il pour l’ensemble de ce passionnant recueil où les poèmes sont nés d’une même urgence et où la beauté des textes résonne comme un rappel de la beauté de la terre que nous détruisons : « Nous nous émerveillons devant la force de la nature / qui se sent traquée et qui réagit en légitime défense », écrit Éric Charlebois.
« Il fait un temps de bourrasques et de cicatrices / un temps de séisme et de chute », constate Hélène Dorion, avis que partage Vincent Lambert : « Je sais / que tout est vraiment en train de / chier », et qui pourtant « imagine que tout finira bien ». Le rêve est peut-être l’ultime refuge ou peut-être faut-il, comme Michel Thérien, « ne jamais fausser la réalité. Dire l’urgence, la violence qui s’agite ».
« Notre présence est-elle nécessaire », se demande Maude Pilon tandis qu’Antoine Boisclair ne peut qu’écrire « ce poème / comme on insère un message au fond d’une bouteille / lancée au hasard dans la mer de plastique ». Mais de quels moyens dispose-t-on individuellement ? « On dit que ton sort repose entre nos mains / les miennes sont trop petites / pour t’attraper », constate Sonia-Sophie Courdeau, à quoi le « où se cache l’espoir / de ne pas finir grillé par le soleil / ou noyé par un océan qui reconquiert la sphère ? » de Daniel Groleau Landry fait écho.
Alors « on devrait s’acquitter de nos fautes / mais au lieu, on demande à qui la faute », affirme Christiane Dunia tandis que Maya Cousineau Mollen constate que « l’intérêt médiatique de ta carcasse / se vautre dans la fange des mots vides ». Le mot de la fin appartient d’ailleurs à Maya Cousineau Mollen qui, reprenant le « How dare you » de Greta Thunberg, ne peut qu’avouer son impuissance : « Je suis comme ces feuilles d’automne / je sublime une dernière fois / je retournerai à la terre / car elle seule sait honorer la vie ».
La qualité des textes de ces 30 poètes (14 femmes et 16 hommes) est à la hauteur du projet. On demeure saisi par cette multiplicité de points de vue qui se rejoignent sur le fond et qui exposent de différentes façons l’angoisse que suscite le réchauffement climatique.