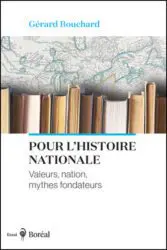Depuis la Révolution tranquille, l’enseignement de l’histoire nationale n’a cessé d’être sujet à controverses. Le dogmatisme conservateur, l’apologie patriotique, voire l’ethnocentrisme qui ont prévalu dans ce domaine jusqu’aux années 1960 ont visiblement laissé des stigmates.
Aussi, dans une société irrévocablement plurielle, est-ce possible d’actualiser l’histoire nationale, de lui redonner quelques lettres de noblesse et de l’intégrer avec profit à la formation scolaire ? C’est à cette vaste question que tente de répondre Gérard Bouchard, historien et sociologue bien connu dont les recherches portent notamment sur les mythes et les valeurs par lesquels les sociétés, en temps de crise, peuvent se redonner des fondements symboliques et des idéaux rassembleurs (Raison et déraison du mythe. Au cœur des imaginaires collectifs, 2014). À défaut de pouvoir ici rendre compte de l’ensemble des propositions, arguments et nuances du chercheur pour réhabiliter et réformer l’histoire nationale, nous en retiendrons deux exemples.
Bouchard propose notamment de concilier ce que l’on tend bien souvent à opposer, à savoir l’histoire nationale et le pluralisme. Pour lui, il s’agit d’activer certaines virtualités de l’histoire québécoise de façon à constituer ce qu’il appelle une « histoire intégrante », à « introduire la diversité dans le sujet de l’histoire nationale, sujet traditionnellement tenu pour homogène, qui tendait à exclure les minorités ». À cette fin, il recommande de « tabler sur des valeurs de portée universelle que tous les citoyens peuvent s’approprier » (la démocratie, l’égalité, la liberté, la solidarité, la justice sociale, etc.) tout en s’assurant de les ancrer « dans la singularité du passé québécois » (les origines, les rébellions de 1837 et 1838, la survivance, etc.). Placée ainsi à l’enseigne de l’universel, l’histoire nationale serait appelée à redevenir un réservoir où puiser « des idéaux transposables que nous pourrions adopter et cultiver aujourd’hui comme héritage à enrichir ou comme matériau identitaire capable de nous inspirer et de nous élever ».
Comment maintenant enseigner cette convergence de l’universel et du singulier ? « L’histoire nationale doit parler au cœur autant qu’à la raison. » Bouchard plaide pour le retour du récit et de l’émotion dans l’enseignement de l’histoire, mais sans compromettre les règles d’objectivité, d’examen critique et d’impartialité. Partant du postulat que « les jeunes sont avides de récit », il induit que ces derniers seraient plus disposés à recevoir la matière, voire à la penser et à la retenir. Et il n’a sans doute pas tort si l’on en croit les neurosciences qui, depuis quelques décennies, reconnaissent la portée cognitive des affects et des émotions. Mais bien entendu, ce rééquilibrage entre l’histoire racontée et l’histoire expliquée, entre le narratif et la factualité, doit être tenu rigoureusement à l’écart de toute forme d’endoctrinement idéologique.
En somme, plutôt que la méfiance et la suspicion, l’histoire nationale devrait selon Bouchard éveiller « un attachement, un sentiment favorable à la société à laquelle on appartient ». Sous-tendue par une approche conciliatrice louable, son analyse est bien documentée (prenant notamment appui sur un corpus de 103 manuels d’histoire en usage au Québec de 1804 à 2018) et s’évertue à désamorcer les objections qu’une telle « sensibilisation par les valeurs » pourrait susciter. Les possibilités et les modalités d’application pratique en classe restent toutefois en grande partie à déterminer. Sans doute est-ce aux enseignants et aux didacticiens de se prononcer !