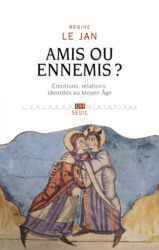Des vers courts, des répétitions pour dire l’éternel retour du même, mais aussi une parole régulière, un flot constant et imperturbable pour dire la mort, l’impensable. Toujours à la recherche d’espaces habitables, Jean Royer se love dans la solitude de la poésie pour affronter cette mort qui traverse le recueil. Sa solitude est toutefois peuplée de dialogues avec une quantité d’auteurs (Gaston Miron et Héraclite d’Éphèse en tête) qu’il salue et cite abondamment. Il convoque des « âmes amies » de tous les siècles pour interroger son époque. La mort et le souvenir sont ici les thèmes majeurs de ce projet humaniste au sens ancien.
La mort : une roche dans l’eau, qui fait des ronds, des ronds qui s’estompent. La véritable mort survient toutefois lorsque disparaît la dernière onde de mémoire, disait Marie Uguay dans un entretien avec Jean Royer. Avec la forme dialogale et l’union des contraires, il interroge la poésie, ce presque rien, cette vie irréductible, d’une manière qui rappelle celle des présocratiques et leurs éléments primordiaux. Il lance des noms comme des pierres dans le fleuve, remue l’onde ; la littérature devient antidote à la mort. S’en dégage des confidences apaisantes et une critique lucide, calme, des atrocités en tous genres (« mesure ta colère / à ton intelligence », dans « Le feu veille le feu »). Le langage canalise la révolte qui prend une tournure posée, méditative, convoquant l’amour et l’accompagnement. Malgré des accents parfois légèrement sentencieux et un je-ne-sais-quoi d’abrupt dans ce name dropping, l’efficace des citations porte : pensée et mémoire sont en éveil.
Il y a un souffle antique dans ces vers écrits au « tu », intriquant destinataire et destinateur. Adresses de la poésie au poète, du poète au poète, du poète au lecteur, qui sait ; le recueil s’inscrirait alors dans la suite des Pensées pour moi-même de Marc-Aurèle ou de Rilke écrivant au jeune poète.