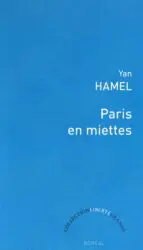Comment rendre compte d’un séjour à Paris, ville mythique s’il en est, tant de fois décrite et doublée d’un signifié culturel incontournable ? Si on connaît relativement bien comment ce défi est relevé dans les récits de voyage, il en va tout autrement dans la fiction.
D’où l’intérêt de l’essai de Yan Hamel, qui s’intéresse à « des romans parisiens » d’autrices et d’auteurs québécois, c’est-à-dire à des romans mettant en scène un personnage qui séjourne dans la Ville Lumière. Le corpus retenu comprend une douzaine d’œuvres, qui vont de La montagne secrète (1961) de Gabrielle Roy à Forêt contraire (2014) d’Hélène Frédérick, en passant par des romans de Marie-Claire Blais, Michel Tremblay, Anne Hébert, France Daigle, Gail Scott, Jacques Poulin, Jacques Godbout et Victor-Lévy Beaulieu.
Compte tenu de la perspective diachronique de ce corpus, on s’attendrait à une variété d’expériences. Hamel y relève plutôt « les symptômes d’une fixation commune ». En effet, les protagonistes de ces romans sont tous, sous une forme ou une autre, appelés à vivre une amère déconvenue. Considérée depuis le XIXe siècle comme La République mondiale des Lettres (Pascale Casanova, Seuil, 1999) et un haut lieu de consécration et d’enrichissement culturels, Paris n’offre aux héros québécois que des « rencontres superficielles et décevantes », des « moments déshumanisants », « une douloureuse impression de s’anéantir », « une errance désœuvrée, insignifiante, aux confins de la désertification mentale ». Aussi le rêve tourne-t-il parfois au « cauchemar » et le Rastignac de province, en « inéducable sauvage canadien ». Que déduire de ce Paris désenchanté du roman québécois et de ces attentes déçues ? Témoignent-ils, comme le déplore Hamel, de « notre obsession », de « la reproduction complaisante d’une médiocrité » et d’« un profond complexe d’infériorité doublé d’une mélancolie sourdement autodestructrice » ? Peut-être ! Mais pourrait-on également y voir une illustration de la fortune des récits de l’échec et de la déroute dans l’imaginaire de la modernité ? Depuis le XXe siècle, en effet, les rites de passage ratés, les rituels initiatiques déconstruits percolent dans la production littéraire. Au demeurant, peut-être faut-il réduire en miettes le mythe extatique et iconique de Paris pour parvenir à renouveler certains lieux communs à l’égard d’une admiration de convention et d’une approche hiératique ? L’insistance qu’y mettent nos romancières et romanciers est-elle le signe du syndrome typique d’une incurable aliénation (que l’on pourrait à la limite faire remonter à l’injonction du Restons chez nous ! de Damase Potvin) ou de la recherche d’une autre parole, « condition même d’exercice de toute littérature moderne », comme disait Pierre Nepveu (1988) ? Des études comparatives sur d’autres destinations que la capitale française pourraient sans doute être révélatrices à cet égard. Mentionnons en terminant que Hamel ne manque pas d’originalité dans son approche en proposant un essai dans lequel il fait alterner des poèmes syncopés de son cru et des recoupements entre les désillusions éprouvées par les personnages. À travers cette combinatoire, le lecteur chemine dans une stimulante réflexion sur notre énigmatique et obscure relation à la Ville Lumière.