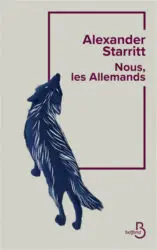Devenu vieux, Meisner, dit Opa, ancien artilleur de la Wehrmacht, résiste à la curiosité de son petit-fils Callum (établi en Grande-Bretagne) qui voudrait savoir « comment c’était ». Mieux vaut ne pas réveiller les démons du passé… Puis il se décide à lui raconter son histoire pour le satisfaire, mais surtout pour être au clair sur la question et en paix avec lui-même.
Il précise d’emblée : il n’a connu les camps de concentration que par le livre de Primo Levi. Il n’était pas nazi et il ne dresse pas un tableau de l’hitlérisme en guerre. Il se contente de dire ce qu’il a vu, le peu qu’il a vu. Le roman se conforme ainsi à la perspective narrative limitée à celle d’un personnage, devenue depuis longtemps canonique dans le genre.
Les faits rapportés se déroulent dans les années 1943-1944 sur le front de l’Est, qui n’avait aucune commune mesure avec celui de l’Ouest. Dans ses Journaux de guerre, Ernst Jünger décrit l’occupation de la France, et spécialement de Paris. Certes, l’aviation alliée venait bombarder les usines, la Résistance commettait des attentats qui entraînaient l’exécution d’otages, la Gestapo surveillait non seulement les civils français mais aussi les gradés allemands. Cependant, la vie quotidienne de l’occupant était dans l’ensemble tranquille, et même confortable. Les soldats allemands redoutaient surtout d’être envoyés sur le front russe, d’où l’on rapportait des horreurs. Ce n’était plus en effet la marche triomphale des conquérants ne devant durer que trois semaines, mais la boue de l’Ukraine où le matériel roulant et les tanks s’immobilisaient, les hivers terribles et, surtout, les partisans russes insaisissables qui surgissaient à tout moment et ne laissaient aucun répit aux troupes allemandes. Puis, en février 1943, toute une armée encerclée à Stalingrad connut la honte de la reddition.
Déjà, les soldats dont Meisner faisait partie, sentaient et savaient que la guerre était perdue pour eux. C’est dans ce contexte de la défaite prochaine – ou plutôt déjà commencée –, de la peur, de la souffrance quotidienne, du découragement, de la débâcle morale sans appel que se déroule le roman d’Alexander Starritt, jeune écrivain d’origine à la fois allemande et écossaise (ce qui lui permet de donner une double perspective sur les faits rapportés).
Meisner le grand-père n’a pas accompli de faits d’armes, nul héroïsme et vantardise chez lui ni chez les quatre compagnons dont le lecteur suit les errances. Hommes égarés ne retrouvant plus leur unité, ne devant compter que sur eux-mêmes pour satisfaire leur désir : survivre et manger. Pour cela, ils n’ont plus rien à perdre ; ils prennent tous les risques en traversant des villages incendiés dont tous les habitants ont été pendus et où demeurent des traces d’une sauvagerie inouïe (on ne dit pas qui en est l’auteur). Ils doivent même faire le coup de feu contre des gendarmes, leurs compatriotes, qui ont pour tâche de protéger des réserves alimentaires. Le récit enregistre sobrement et sans détours, parfois avec une extrême brutalité, en conservant la vulgarité des propos échangés entre ces hommes qui sont en fait des déserteurs, toujours travaillés par la peur et l’idée du suicide. Le roman montre comment une armée qui se croyait invincible se désagrège et se pourrit dans une débâcle morale accompagnant celle des armes, et à quel degré de cruauté, de barbarie peuvent descendre des hommes en guerre. Meisner, rétrospectivement, fait son examen de conscience : a-t-il bien agi dans les circonstances ? L’enjeu pour lui était de « préserver une menue enclave lumineuse de vie intérieure ». A-t-il réussi ?
Le livre n’a pas pour objet (peut-être au risque de tromper l’attente du lecteur) de rouvrir la polémique sur la responsabilité allemande collective, ni sur la dénazification et la réinsertion des dirigeants nazis dans de hautes fonctions de la République fédérale contemporaine. Il retrace plus modestement un parcours singulier qui, la vieillesse venue, conduit l’homme à une réflexion morale. Meisner passe vite sur les événements qui suivent son évocation du front de l’Est. Après sa captivité dans un camp russe, sa libération, il change pour ainsi dire de patrie, passant de l’Allemagne de l’Est à la République fédérale. Étrangement, il ressent de la mélancolie – trait de l’âme allemande aux yeux du romancier – en entendant des chants encore connus chez ceux qui essayent de reconstruire le pays en ruines. « Ce qui a changé, c’est qu’on admet à présent que les Allemands parlent de leurs souffrances. Et on a envie d’en entendre parler, parce qu’on croit à un lien entre souffrance et vérité. Avoir souffert, dans mon expérience du moins, cela vous fait voir le monde sans cette façon de tout ramener à soi innée à chacun de nous […] nous formons une vaste foule grouillante et indistincte où les uns souffrent et d’autres coulent des jours heureux, sans raison à cela. »
Ce livre s’ajoute à la riche bibliographie du roman de guerre, et il pose la double interrogation de la reconstitution du passé par l’auteur et de l’enrichissement de la documentation sur ce passé. Ainsi, Andréï Makine parle, dans plusieurs de ses œuvres, de la guerre en Russie alors qu’il ne l’a pas connue. Pierre Lemaitre décrit la débâcle de 1940 comme s’il y avait participé. Le tour de force le plus étonnant est sans doute Les bienveillantes, d’un Jonathan Littell qui a interrogé archives, journaux, carnets, correspondances pour narrer les sinistres faits d’armes d’un officier nazi chargé de l’élimination des Juifs en Europe. Et que dire du finale de Nous, les Allemands, qui raconte dans un morceau de bravoure stupéfiant comment Meisner et ses compagnons se sont emparés d’un tank russe, dont le lecteur apprend le maniement en même temps qu’eux ! D’où vient cette science de l’auteur ? Exemple à la fois des exigences de la création romanesque, du travail de l’imagination, et de sa réussite.