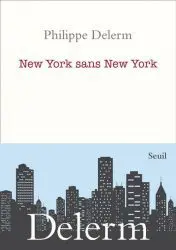Étrange, conclut l’auteur, d’avoir choisi New York comme sujet de son dernier livre. Non pas pour n’y être jamais allé, ce qui est le cas, mais pour faire de ce refus le ressort même du présent livre. La fascination, la force d’attraction qu’exerce New York s’en trouvent ici décuplées.
Pour celui que l’on désigne aujourd’hui comme le représentant de l’instantané littéraire, le genre qu’il aura contribué à faire rayonner depuis La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules, la ville debout, surnommée ainsi par Louis-Ferdinand Céline, offrait un terrain d’exploration inépuisable tant et aussi longtemps qu’il se refuserait à confronter la réalité aux images et aux souvenirs qui découlaient de reproductions de livres scolaires, d’affiches, de lectures, de films, d’albums écoutés en boucle qui, tous à leur manière, ont nourri le mythe de la mégapole dans son esprit et qu’il a tenu à préserver jusqu’à ce jour. N’est-on pas le plus souvent déçu de voir porter à l’écran un roman que l’on aura aimé, de ne pas retrouver dans les personnages mis en scène l’intensité et la profondeur qu’on leur prêtait à la lecture ? Ainsi en est-il de New York pour Philippe Delerm : la ville maintes fois imaginée conservera son attrait et son pouvoir tant qu’il la vénérera à distance. Cette affection verse par moments dans la dévotion et n’est sans doute pas étrangère à l’émerveillement qu’exerce New York sur les Européens. La réticence de Delerm à prendre l’avion lui a jusqu’ici permis de protéger la ville idéalisée surgie des images engrangées au fil des ans.
New York émerge donc des souvenirs de l’auteur et s’érige à partir des impressions, des affiches et des pochettes de disques devenus mythiques qu’il rappelle à notre mémoire, tel l’album The Freewheelin’Bob Dylan sur lequel on voit le chanteur, le col relevé et les mains dans les poches, arpenter une avenue de la Grosse Pomme au bras d’une jeune femme, avant même que New York n’hérite de ce surnom. Delerm, fidèle à son habitude, s’attarde aux menus détails pour nous entraîner à sa suite dans son New York revisité, comme Henri Calet avait su le faire pour Paris. Philippe Delerm se fait un point d’honneur de rapporter quelques anecdotes et réminiscences ayant nourri cette fascination pour New York, dont le spectacle donné par Simon and Garfunkel à Central Park, le 19 septembre 1981. Et nous voilà à notre tour lancés sur les pas de James Dean, de Woody Allen, de Paul Auster, d’Herman Melville – pour ne nommer que ceux-là – qui, chacun à leur façon, ont contribué à mythifier « la ville qui ne dort jamais ». Le portrait qui en découle est magnifié, idéalisé, voire édulcoré, mais il s’agit avant tout, on l’aura compris, d’une célébration, celle d’une ville imaginée de toutes pièces à même les émotions qu’elle a fait naître chez Philippe Delerm. New York garde ici toute sa grandeur, intacte sa force onirique. « Il y a tant d’occasions d’être infidèle à son esprit d’enfance. Je n’ai pas voulu celle-là », conclut Delerm.