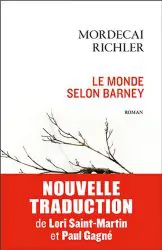Mordecai Richler avait du talent, autant pour écrire que pour semer la zizanie. Son alter ego Barney Panofsky, protagoniste du roman Le monde selon Barney, lui ressemble : il écrit et il sème la zizanie.
« Œuvre majeure de la littérature canadienne », comme le rappelle avec raison la quatrième de couverture, cette quasi-autobiographie est le dernier livre de l’auteur, paru quelques années avant que celui-ci ne disparaisse en 2001, à l’âge de 70 ans. Aujourd’hui magnifiquement traduit par Lori Saint-Martin et Paul Gagné, Le monde selon Barney a reçu le prix Giller en 1997, prix qui récompense le meilleur roman – ou recueil de nouvelles – canadien, publié en anglais ou traduit en anglais, et a été porté à l’écran en 2010, par le réalisateur torontois Richard J. Lewis.
Plus que jamais, ou du moins autant que dans d’autres œuvres magistrales de Richler, tel L’apprentissage de Duddy Kravitz (1959) ou Joshua au passé, au présent (1980), il sera souvent question dans Le monde selon Barney des « deux solitudes », terme cher à Hugh MacLennan et tiré du livre éponyme publié en 1945. Richler/Barney sont tous deux issus de la communauté juive anglophone de Montréal et se délectent à pourfendre autant leur propre communauté que celle des « Canadiens français », comme on disait à une certaine époque. En 1995, lors du deuxième référendum invitant les Québécois à se prononcer sur la souveraineté de leur province, un des personnages du romanest « certain que le reste du Canada va boycotter les vêtements qu’il produit […]et songe sérieusement à faire coudre une étiquette Made in Ontario sur [ses] jeans, au cas où ces salauds l’emporteraient ». Le ton est donné.
Richler/Barney possèdent un sens de l’humour dévastateur et un goût irrépressible pour la provocation. Tout passe à la moulinette de l’ironie, y compris eux-mêmes, qui pratiquent l’autodérision à de hauts niveaux et qui attaquent à peu près tout ce qui bouge : racistes de tout acabit, indépendantistes, féministes, communauté juive – sépharades ou ashkénazes –, nouveaux riches d’Hampstead ou de Ville Mont-Royal, et bourgeois parvenus fréquentant le Ritz-Carlton. « La fille travaille au comptoir de la parfumerie Lanvin chez Holt Renfrew et c’est pour cette raison que je n’y mets plus les pieds, elle est trop familière, je n’aime pas ça. »
Barney avait deux croyances auxquelles il s’accrochera toute sa vie : « Primo, la vie est absurde ; secundo, les humains ne se comprennent jamais vraiment ». Alors pourquoi se priver ? De son passage à Paris dans les années 1950 jusqu’à son retour à Montréal où il fait fortune dans le cinéma et la télévision, le personnage vit intensément. Rongé plus tard par la rancœur et les remords, il plongera dans l’écriture de ses mémoires, en partie pour se défendre du meurtre de son meilleur ami, Bernard « Boogie » Moscovitch, meurtre qu’il n’a par ailleurs pas commis. Il deviendra complètement sénile et finira ses jours dans une résidence de type CHSLD où ses enfants, son ex-épouse Miriam et ses maîtresses viendront le visiter.
Le monde selon Barney est divisé en trois parties, chacune portant tour à tour le nom de l’épouse du moment. À Paris, alors qu’il fréquente la bohème artistique, Barney demande en mariage la poète Clara Charnofsky, qui se dit enceinte de lui ; elle se suicidera et deviendra célèbre après sa mort. « J’ai bien peur que les nouvelles soient mauvaises, Cedric. Hier, tu as perdu un fils. Celui de ma femme. » Revenu à Montréal, il épouse la deuxième madame Panofsky, une « fille de bonne famille juive américaine qui se prend pour la reine de Saba » et qui ne sera jamais nommée, mais qu’il trompera le jour même de ses noces. Sa troisième femme sera le grand amour de sa vie et la mère de ses enfants ; elle le quittera après plus de trente ans de vie commune. « Miriam était partie depuis trois ans, désormais, et je dormais toujours de mon côté du lit. En me réveillant, je la cherchais à tâtons. Miriam, Miriam, élue de mon cœur. »
Les mémoires de Barney sont difficiles à suivre. Elles sont faites d’incessants allers-retours dans le temps, truffées de personnages secondaires et d’évocations de célébrités bien connues à l’époque, ce qui ajoute à la confusion déjà existante. Barney a tous les défauts de la terre, ivrogne, grossier, menteur, de mauvaise foi, et j’en passe, pourtant il demeure attachant. Dans un élan de sincérité, il se définit lui-même : « Pour la crème de l’humanité, cependant, je demeure infréquentable. Par chance, cette espèce reste rare à Montréal ». Infréquentable, Richler le demeurera particulièrement après avoir publié Oh Canada ! Oh Québec ! Requiem pour un pays divisé (1992), un ouvrage pamphlétaire et polémique qui dénonce le nationalisme québécois et ses lois linguistiques.
Mordecai Richler, aussi vénéré que détesté, demeure un grand romancier canadien. Il a remporté deux fois le Prix du Gouverneur général, ainsi que le prix du Screenwriters Guild of America. En plus du prix Giller pour Le monde selon Barney, il a remporté le prix Hugh-MacLennan de l’Association Quebec Writers et a été nommé Compagnon de l’Ordre du Canada en 2000. Cinq de ses romans ont été adaptés au cinéma.
Près de deux décennies après sa mort, la Ville de Montréal a donné son nom à la bibliothèque du Mile End, son quartier d’enfance. Pas très loin de là, au pied du Mont-Royal, un kiosque à musique porte aussi son nom. Sur la rue Laurier, une gigantesque murale le rappelle à la mémoire de tous.
ESPACE PUBLICITAIRE
DERNIERS NUMÉROS
DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE
Loading...