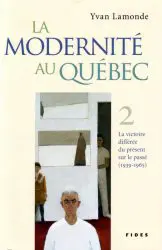Au-delà d’une querelle d’historiens, l’enjeu de la réflexion sur le statut de la Révolution tranquille concerne le présent et l’avenir de la collectivité québécoise. Puisque le Québec n’a pas basculé dans la modernité un certain 22 juin 1960, avec la victoire électorale de Jean Lesage et du Parti libéral, reste à expliquer comment cela s’est préparé, depuis le cœur même de la « grande noirceur ». D’un autre côté, l’image d’une trame sans rupture, de l’après-guerre aux années 1960, est loin de faire l’unanimité.
À tout le moins, il faut reconnaître au débat d’avoir forcé les uns et les autres à scruter avec plus d’attention cette période charnière de l’histoire du Québec (consacrant du coup son statut de période charnière). Parmi ces travaux attentifs, ceux d’Yvan Lamonde comptent parmi les essentiels.
Avec ce deuxième tome de La modernité au Québec, Lamonde ajoute un étage à l’édifice imposant de ses travaux sur l’histoire des idées au Québec, menés depuis plus de 40 ans. Le professeur émérite de McGill le précise en introduction, son ouvrage, qui couvre les années 1939 à 1965, est nourri par les essais publiés au cours de cette période, y compris les articles de journaux et de revues phares comme Le Devoir, Cité libre, Liberté et Parti pris.
Lamonde fait voir, entre autres contrastes, comment le temps de guerre exacerbe le conservatisme canadien-français, alors que les femmes obtiennent le droit de vote et que la fréquentation scolaire devient obligatoire jusqu’à quatorze ans. La mainmise conservatrice de Duplessis et du clergé catholique domine la plus grande partie de l’après-guerre, ce qui n’empêche pas l’expression d’une soif de liberté dans la production intellectuelle et artistique. Le nationalisme est attaqué en tant que séquelle du passé et obstacle à la modernité, par des intellectuels libéraux, Pierre Elliott Trudeau en tête. La réponse sera cinglante, non seulement à travers l’œuvre littéraire des Miron, Aquin et autres Vadeboncœur, mais au vu de la montée de l’indépendantisme, « comme si la progressive évacuation du religieux faisait place à une progressive entrée dans le politique ». Au terme du parcours, reprenant la formule de Fernand Dumont, Lamonde constate qu’un « vide spirituel » est toujours à combler.
ESPACE PUBLICITAIRE
DERNIERS NUMÉROS
DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE
Loading...