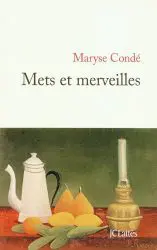Qu’est-ce qui distingue l’écriture de la cuisine ? La première abhorre la répétition, tandis que la seconde en redemande. N’est-ce pas ? C’est en tout cas ce qu’affirme Maryse Condé, dont le succès absolu est la jambalaya, un grand plat du sud des États-Unis. Passion, dites-vous ? Absolument ! Même si ce rapprochement peut choquer les âmes sensibles, qu’à cela ne tienne : c’est l’objet même du livre, d’autant plus qu’elle lui permet de lutter contre l’exclusion (des littératures guadeloupéenne, africaine et afro-américaine) dont elle s’est toujours sentie victime. Plus encore : c’est un moyen de transgresser l’interdit édicté par la mère, à savoir que seules les personnes peu évoluées s’occupent de la cuisine.
Les lecteurs de la grande globe-trotteuse savent qu’elle ne fait pas dans le politiquement correct qui a envahi nos discours. C’est son abord direct de la vie, accompagné d’un continuel travail de mémoire, que l’on retrouve dans ce nouvel ouvrage aérien qui tient de l’écriture de soi, sans tomber dans l’illusion autobiographique ou dans la détestable mode de l’autofiction. La petite fille curieuse à qui l’on avait insufflé la « conviction d’appartenir à une espèce supérieure » (La vie sans fards) est tout entière sa vie durant happée par les saveurs et les odeurs du monde, mais c’est à New York qu’elle découvre, sur le tard même si elle y a tant habité, « que pour connaître la cuisine d’un pays il n’est pas nécessaire de voyager ». D’ailleurs, ajoute-t-elle, « [l]es plats n’ont pas de nationalité ». Voilà qui explique que ce soit dans la capitale économique de l’Occident qu’elle déguste le fameux imam bayildi, un plat turc à base d’aubergines et de tomates. Reste que ses nombreux voyages ouvrent la dimension ethnologique de la nourriture : « Visiter un supermarché est aussi instructif que parcourir un musée ou une salle d’exposition ». Sans oublier le versant économique : « […] la culture et la cuisine d’un pays ne dépendent-elles pas aussi de sa condition socio-économique ? » Ce que nous avons tendance à perdre de vue, tant nous nageons dans une orgie de bouffe que la télévision ne cesse de promouvoir. C’est cette conscience aiguë – parfois minorée par une étonnante naïveté politique (par exemple, lors de son séjour en Israël) – qui fait le charme de la gourmandise de l’auteure.
En accompagnant l’ancienne élève de René Étiemble, nous rencontrons ainsi mille plats de tous les continents, que la cuisinière, héritière de sa grand-mère Victoire, sait déguster et parfois même préparer avec la touche de créativité qui la caractérise. Du mafé de Winneba, au Ghana, aux rillettes de maquereau et au far d’Ouessant, typiques de la Bretagne, en passant par le tajine aux abricots secs et aux amandes, dégusté à Gabès, rien ne l’indiffère et elle exulte lorsque l’anthropologue Robert Jaulin l’invite à donner un cours d’ethno-cuisine avec sa femme. De même, avec une autre anthropologue, Maria Azzaro, c’est la cuisine plus que les réflexions sur Octavio Paz qui l’émerveille. Et si l’acteur James Campbell la séduit dans La tragédie du roi Christophe, c’est surtout ses dons en assaisonnements qu’elle vénère.
La leçon de ce livre : l’imitation ne mène nulle part. Devant la tradition, il faut réinventer. Mais il y en a une autre : la cuisine est politique. Le plat traditionnel de l’Afrique du Sud s’appelle le pad. Il unirait, dit-on, les Blancs et les Noirs.
ESPACE PUBLICITAIRE
DERNIERS NUMÉROS
DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE
Loading...