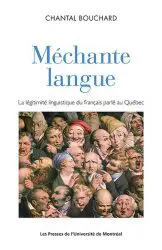La linguiste, professeure à l’Université McGill, s’emploie dans cet essai à faire la lumière sur ce qui explique la perte de prestige du français parlé au Canada à l’approche du milieu du XIXe siècle, alors que, sous le Régime français, les visiteurs étrangers soulignaient sa conformité au bon usage de Paris. La Révolution française est-elle en cause ? de s’interroger l’essayiste.
Dans un premier temps, Chantal Bouchard scrute les variations phonétiques et lexicales observées en France après la chute de l’Ancien Régime et en identifie les causes et les provenances. D’après son analyse, la plupart des transformations étaient déjà présentes dans la langue populaire depuis les XVIe et XVIIe siècles, à l’exception du vocabulaire propre à traduire les nouvelles réalités sociales et politiques. Après la Révolution, une nouvelle hiérarchie politique, de même que le développement de la scolarisation et la prépondérance de l’écrit sur l’oral agiront comme facteurs de diffusion et d’unification linguistiques dans l’État centralisateur.
Au Canada, l’ancien modèle survit. Ce qui permet à l’essayiste d’affirmer qu’il s’agit d’un effet tardif de la Révolution française sur la langue parlée au Canada devenu colonie britannique en 1763, donc avant la Révolution. Cette langue considérée comme légitime devient objet de mépris à peine deux ou trois générations après la Conquête. En effet, en 1841, éclate une polémique linguistique à la parution du Manuel des difficultés les plus communes de la langue française, adapté au jeune âge, suivi d’un recueil de locutions vicieuses, de l’abbé Thomas Maguire. L’abbé Jérôme Demers critiquera vivement le manuel par la voie des journaux. Se mêleront à la bataille linguistique les journalistes Étienne Parent et Michel Bibaud. Si les polémistes s’entendent pour éliminer les anglicismes de toutes sortes, ils diffèrent d’opinion quant à la légitimité des archaïsmes, provincialismes et néologismes ainsi que sur nombre de traits de prononciation. Le Québécois d’aujourd’hui ne sera pas dépaysé à la lecture de cette controverse. Car si les termes du débat linguistique ont depuis varié en fonction des contextes, l’insécurité linguistique, elle, subsiste.
En fin de parcours, l’auteure déplore l’attitude centralisatrice de Paris en matière linguistique et se demande s’il en est ainsi des autres langues à l’égard de leurs anciennes colonies. Souhaitons qu’elle examine cette question dans un prochain essai.