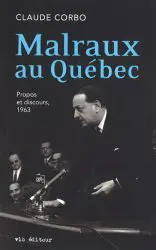Du 7 au 15 octobre 1963, André Malraux, écrivain immense et ministre de la Culture du général de Gaulle, était en visite au Canada – et surtout au Québec.
Dans les années 1960, les relations entre la France et le Québec ont connu le sort du phénix qui renaît de ses cendres (ou peut-être de ses glaces en l’occurrence). Les planètes étaient alignées pour cette redécouverte du « Canada français » par sa « mère patrie » : d’une part, le nouveau gouvernement de la Révolution tranquille était convaincu qu’il avait besoin de la France pour son affirmation nationale et le développement du français ; d’autre part, le général de Gaulle éprouvait pour le Québec un intérêt sincère, et la réelle intention de jouer pour lui le rôle de grand frère.
Georges-Émile Lapalme, chef du Parti libéral dans l’opposition de 1950 à 1958, était souvent intervenu à l’Assemblée législative du Québec pour réclamer l’implantation d’une Maison du Québec à Paris. Mais ce n’était pas dans les priorités du gouvernement duplessiste. Nommé à la tête du tout nouveau ministère des Affaires culturelles du Québec en 1961, Lapalme aura le feu vert de Lesage.
Il faut lire le récit de l’audience de Lapalme venu faire la proposition dans le bureau de Malraux. Cette première rencontre n’avait pas vraiment été planifiée, et Lapalme, en visite à Paris, avait été invité à moins de 24 heures d’avis. Comme le rapporte dans une lettre son compagnon Maurice Riel : « C’était bien beau d’avoir formé des idées au cours de la période de l’opposition et d’avoir rêvé d’établir des relations entre le Québec et la France […], mais aller raconter tout cela à Malraux, ce qui semblait l’affaire la plus simple du monde, il y avait à peine deux instants, était subitement devenu une chose de proportions énormes. Aller voir Malraux ? Mais que lui dire ? Comment le dire ? »
On sent ici le même complexe que celui qui habitait Daniel Johnson devant un de Gaulle qui était prêt à faire du Québec un interlocuteur privilégié en 1967. Or, comme le démontrera la célèbre harangue lancée du haut du balcon de l’hôtel de ville de Montréal, la France ne voyait à peu près pas de limites à l’appui qu’elle pouvait apporter à cette « francophonie » (le mot apparaît à cette époque) d’outre-mer. « La France n’a de remords qu’envers le Canada français », avait dit de Gaulle par la bouche de son ministre de la Culture. Précurseur du fameux discours de l’« année de l’expo », Malraux saisit toutes les occasions de faire valoir le potentiel du « Canada français ». « Ce que la France peut vous apporter d’essentiel, c’est la confiance en vous. »
Malraux improvisait ses discours. On a donc ici un recueil de ses propos à partir des comptes rendus des témoins et, surtout, des journaux de l’époque, qui lui rendront les honneurs qu’il méritait. (Cet accueil contrastera avec celui que le Québec lui avait réservé lors d’une tournée précédente comme simple écrivain en 1937, époque où il « pass[ait] pour un agitateur communiste chez les nationalistes ».) Au fil de ses interventions, le grand homme au parcours aventurier (il avait pris part à la guerre civile espagnole) et aux connaissances encyclopédiques distillait notamment ses réflexions sur le sens de la civilisation : pour lui, aux côtés des deux grands blocs qu’étaient devenus les États-Unis et l’URSS, il y avait de l’espace pour un troisième esprit civilisationnel auquel devaient participer la France et le Québec. Le Québec devait même, en tant que bastion de la francophonie en Amérique du Nord, trouver sa voie propre, et il avait la capacité de le faire. « Retournez-vous, voyez les gratte-ciel de cette ville [Montréal] qui sont d’une architecture américaine. Peut-être que dans 10 ans ou dans 20 ans ils seront d’une architecture canadienne-française. » Comme le fait ressortir la geste québécoise du général de Gaulle, la France était peut-être à l’époque plus ambitieuse pour le Québec que le Québec lui-même.
L’ouvrage nous replonge ainsi dans une période révolue où tout semblait possible pour un Québec qui, paradoxalement, se sentait à peine prêt pour un tel destin tout en réussissant à accomplir des pas de géant. On saura gré à l’auteur de l’extrême rigueur de son travail, et d’une mise en contexte très complète, caractérisée notamment par un calendrier détaillé du séjour de Malraux au Québec, qui fait de son livre une référence historiographique incontournable.