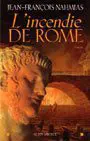L’habitude de détester Néron est si profondément ancrée dans notre imaginaire qu’on accueillera avec surprise sinon avec scepticisme la réhabilitation de l’empereur-artiste que tente Jean-François Nahmias. À en croire cette version, Néron n’a jamais désiré le pouvoir impérial et s’en serait volontiers libéré s’il n’avait pas subi constamment les pressions de Sénèque. Celui-ci, précepteur du jeune roi, lui aurait fait valoir que nul ne choisit son destin : puisque le sien était de régner, il devait assumer la charge. Néron, quant à lui, ne rêvait que théâtre, musique, peinture. Vaniteux ? Oui, si l’on entend par là le désir des applaudissements et des marques d’affection. Cruel ? Ni par penchant naturel ni de son plein gré. On admettra que Nahmias peigne l’histoire à rebrousse-poils. Son récit fait disparaître l’image d’un Néron faisant brûler Rome pour s’offrir un spectacle digne de son chant, tout comme il transforme le Sénèque du De Senectute en vieillard vaniteux et insupportable.
Pour déroutante qu’elle soit, la thèse de Nahmias ne manque pas de séduction. Elle peuple les coulisses de courtisans ambitieux et imagine des complots sans cesse renaissants. Jusque-là, rien d’étonnant. Elle met en scène un peuple romain avide de spectacles et d’une instabilité maladive dans ses enthousiasmes. Là non plus, rien d’invraisemblable. Ce n’est pas d’aujourd’hui que les Romains d’autrefois ont la réputation de ne rêver que de panem et circenses. Ces bases une fois rappelées, Nahmias a beau jeu d’imaginer (ou de reconstituer) un refroidissement des relations entre Néron et son peuple. L’empereur, incapable de vivre sans l’encens des applaudissements, se laisserait convaincre que rien ne vaut une bonne persécution des chrétiens pour reconquérir la faveur populaire. Néron, de sanguinaire qu’il était, devient ainsi un velléitaire opportuniste et malléable. Inattendu.