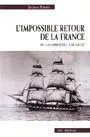En 1855, lorsque le commandant Paul-Henri Belvèze, commandant de division navale de Terre-Neuve, appareille la corvette La Capricieuse en direction de la ville de Québec, sa mission est d’ordre commercial, avec trois objectifs bien précis : établir un consulat à Montréal, alléger des droits de douane sur certaines exportations françaises et obtenir l’entrée en franchise au Canada des morues françaises. Deux ans auparavant, lorsqu’il avait soumis ce projet à ses supérieurs, la France, sous la gouverne de Napoléon III, effectuait un rapprochement avec la Grande-Bretagne, jusqu’à être son alliée durant la guerre de Crimée. Quant aux échanges commerciaux, hautement importants pour la France qui considérait les avantages inhérents à une alliance avec le puissant Royaume-Uni, bien que loin d’être idylliques, ils étaient promis à un bel avenir. Le ministre de la Marine, conscient du délicat travail qui doit être entrepris pour renforcer les liens avec Londres, donne le feu vert au commandant Belvèze, en exigeant cependant que le but de la mission reste strictement commercial.
Toutefois, à son arrivée à Québec, à sa grande surprise, le commandant soulève un enthousiasme hors du commun. C’est une véritable onde de joie qu’il provoque partout où il ira : le drapeau tricolore sort des placards et se met à flotter sur tous les édifices et toutes les maisons, les habitants se précipitent sur les marins, et le navire est visité sans discontinuer. Le commandant est invité à nombre de réceptions et de cérémonies officielles. La cérémonie d’inauguration du monument des Braves sur les plaines d’Abraham sera expressément retardée afin que Belvèze puisse y participer.
La venue de cette corvette sera un symbole d’espoir cher aux yeux des habitants de la ville de Québec, à savoir le retour possible de la France qui, pourtant, n’a jamais considéré reprendre possession de ce territoire perdu. En quelques pages, Jacques Portes, professeur d’histoire nord-américaine à l’Université de Paris-VIII, présente une analyse du contexte qui a entouré ces événements historiques, de la visite de La Capricieuse à celles du général de Gaulle. Relevant du rapport d’analyse universitaire, ce court essai démontre à quel point « les événements historiques tiennent à peu de choses ».