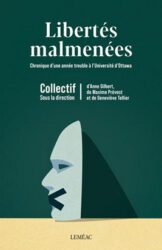Depuis la malheureuse « affaire Lieutenant-Duval » qui a secoué le monde de l’enseignement supérieur en Ontario puis au Québec, la liberté académique semble être devenue une affaire de « deux poids, deux mesures », comme un double-standard, selon l’expression courante au Canada anglais.
Au sein d’une même université, on ne se porte pas à la défense d’une enseignante contractuelle – francophone – devenue victime de cyberharcèlement de la part de ses étudiants parce qu’elle a prononcé en classe le « mot en N »; mais on tolère un professeur permanent qui se plaît – en anglais – à faire du Québec bashing à répétition. Or, si on veut combattre légitimement le racisme, il faut être cohérent et dénoncer du même souffle toutes les formes de discrimination, y compris celles contre les francophones.
Dans le contexte ontarien de nos jours, le speak white des années 1960 pourrait avoir été remplacé par le speak woke. Ce collectif examine toutes les interprétations – celles déformées et colportées dans les médias, mais aussi les analyses de discours faites par des chercheurs – à la suite de la commotion causée involontairement par une professeure non permanente après qu’elle a fait allusion au célèbre essai de Pierre Vallières dénonçant l’exploitation des Canadiens français. Au départ, l’intention était uniquement d’illustrer dans un cours les formes historiques de discrimination et d’ostracisation.
Lui-même victime d’attaques similaires de la part de certains de ses étudiants, Marc Brosseau explique une différence fondamentale entre la mention du « mot en N » (pour étudier le phénomène et comprendre comment celui-ci se manifeste) et son usage (comme une insulte, une invective). Le professeur Brosseau l’a longuement expliqué à des journalistes qui n’auront retenu – on le devine – qu’un bref passage qui a fait le tour du monde (notamment sur les réseaux sociaux) : « Je constate rapidement que dans la presse francophone, la distinction est jugée valide, alors que dans la presse anglophone, usage et mention sont aussi répréhensibles ». Et c’est ainsi que les accusations de racisme ont fusé.
Libertés malmenées constitue un remède éclairant contre les accusations infondées de racisme ou de racisme systémique et contre les dérives de l’EDI (équité, diversité, inclusion), termes auxquels on ajoute « décolonisation » et cette nouvelle tendance de « gouvernance woke universitaire », selon l’expression de la politicologue Geneviève Tellier. À première vue, le principe de départ du wokisme pourrait sembler noble ; mais, telle une secte, cette doctrine radicale est devenue une industrie tentaculaire et très lucrative, avec ses gourous, ses formations parallèles présentées aux directions universitaires comme étant « incontournables », ses généralisations abusives, ses excommunications et ses relents de manichéisme qui départagent arbitrairement les justiciers adeptes du wokisme d’un côté et de l’autre les racistes. À la manière d’un nouveau mantra, c’est ce que beaucoup d’universités américaines adoptent et enseignent désormais aux futures élites. On dénonçait déjà ce manque de discernement et de nuance dans la lutte antiraciste opérée sur certains campus dans le livre The Rise of Victimhood Culture: Microaggressions, Safe Spaces, and the New Culture Wars (Palgrave Macmillan, 2018), mais aussi en France, dans un dossier étoffé sur « L’Université bâillonnée » (2019) de la Revue des Deux Mondes.