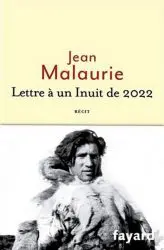Nul mieux que l’immense Jean Malaurie ne pouvait alerter la planète Terre relativement à la vertigineuse détérioration des habitats nordiques et des conditions de vie de leurs populations. En plus d’une indiscutable compétence en ces vastes préoccupations, Malaurie s’est suffisamment approprié le chamanisme et l’animisme des peuples nordiques pour en vanter les couleurs : « L’animisme, auquel j’adhère, relève de la prescience sauvage, mais il n’est pas mesurable parce qu’il est fragile et fugace ». Un tel endossement, venant d’un scientifique de haut vol, constitue un atout majeur dans la tardive et souhaitable réhabilitation des cultures autochtones. Malaurie donne ainsi un puissant écho à des témoignages largement ignorés comme ceux d’Achiel Peelman (L’esprit est amérindien, Médiaspaul, 2004) et de Charles-Ferdinand Ramuz (La pensée remonte les fleuves, Plon, 1979). Ce dernier ouvrage fait partie intégrante de la collection « Terre humaine », créée par Malaurie.
Cela étant fermement établi, il est quand même dommage de voir le peu d’espace qu’a réservé Malaurie à son irremplaçable plaidoyer en faveur des Autochtones. Il les épaule, mais pas assez. Plus que quiconque, il a vu les sinistres résultats de la centralisation que divers pays, y compris le Canada, imposent aux peuples nordiques : « […] des économistes européens et notamment danois souhaitent regrouper les villages de moins de 100 habitants, considérant que leur gestion est coûteuse. Des contre-études ont pu établir qu’un tel jugement est fallacieux. Le coût des infrastructures de grandes villes est élevé, étant également observé que c’est attenter à l’âme du peuple qui se réfugie dans les villages ». La force de Malaurie, c’est qu’il peut ajouter à ces observations cliniques une fervente empathie envers les convictions religieuses des Autochtones. Il écrit d’ailleurs ceci, pleinement conscient de son apport : « J’ai pu lever un scandaleux malentendu sur leur primitivité et établir qu’ils vivaient avec sagesse dans une société d’équilibre écologique reposant sur des principes animistes qu’ils considéraient comme intangibles ». D’où sa pression sur le jeune Inuit pour qu’il se dresse contre « la société matérialiste que leur proposent les Danois » et qu’il ose la défense de « la pensée sauvage ». Fort bien.
L’étonnant, ce sera que Malaurie réserve quand même la majorité de ses pages à étaler ses innombrables présidences et ses non moins nombreuses décorations. Malaurie succombe aussi à la tentation d’attacher à son char des sommités qui n’en demandent pas tant : bon gré mal gré, Claude Lévi-Strauss, Roger Caillois, Roger Bastide, Gaston Bachelard et consorts défilent sous sa houlette. De la part d’un géant aux mérites indiscutables et indiscutés, pareille inélégance attriste. Mais peut-être la nostalgie est-elle admissible à 94 ans.
ESPACE PUBLICITAIRE
DERNIERS NUMÉROS
DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE
Loading...