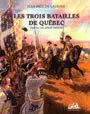De livre en livre, Jean-Paul de Lagrave défend ses vues avec une fougue constante et une documentation minutieuse. Il passe avec aisance de la vérification studieuse d’un registre oublié à la défense de figures entrées bon gré mal gré dans la légende. On le sent d’ailleurs prêt à engager la discussion à propos de tout ce qui peut éclairer l’histoire du Québec. Comment ne pas partager son enthousiasme et ses déceptions ?
De Lagrave revient ici sur l’importance et la fréquence des trahisons perpétrées aux moments les plus stratégiques de la défense de la Nouvelle-France. Ces moments sont nettement situés : 1759, 1760, 1775. La traîtrise, il la constate d’abord chez ceux qui guident les soldats anglais jusqu’aux plaines d’Abraham ou qui permettent aux navires ennemis de s’ancrer à loisir devant la ville de Québec pour la mieux bombarder, mais de Lagrave la détecte aussi chez les grands de ce monde. À ses yeux, Montcalm fut vaincu par l’incompétence du gouverneur Vaudreuil plus encore que par les troupes de Wolfe. D’autres personnages, sans encourir ce blâme dévastateur, encourent un jugement presque aussi sévère : ils commandaient alors qu’ils possédaient tout au plus le gabarit de l’exécutant. Tous ne seront pas d’accord, mais de Lagrave aura obligé les contradicteurs à étoffer leurs réticences.
Deux aspects (au moins) relèvent de la sociologie autant que de l’histoire. D’une part, affirme et martèle l’auteur, le clergé québécois, surtout au palier épiscopal, a joint le camp du conquérant et exigé des fidèles qu’ils en fassent autant. D’autre part, le peuple québécois, s’il n’en avait tenu qu’à lui, aurait volontiers suivi les Étatsuniens dans leur marche vers l’autonomie politique. Autant d’affirmations fortement étayées et difficilement contestables. Quand l’essayiste succombe à la tentation du ton péremptoire et érige ses convictions en dogmes inattaquables, il est bon de se rappeler qu’il a bien construit ses thèses.