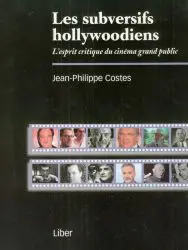Critique de films et encyclopédiste sur Internet, Jean-Philippe Costes présente dans son premier livre (du moins sur papier) un florilège de 29 réalisateurs américains qu’il considère comme étant subversifs. Sa liste personnelle comprend des auteurs légendaires comme John Ford, Orson Welles et George Cukor, mais aussi plusieurs noms surfaits comme Quentin Tarantino, Brian De Palma ou les frères Coen. En quoi tous ces hommes de cinéma ont-ils défié les tabous de l’Amérique ? Chacun a procédé à sa manière. Ainsi, pour Douglas Sirk, Costes écrit : « Le sentimentalisme et les sanglots longs des violons ne sont plus des aberrations narratives mais des verres grossissants, plaqués sur des réalités que beaucoup ne veulent voir sous aucun prétexte ». Ailleurs, l’auteur interprète La Mort aux trousses (1959) d’Hitchcock comme une mise en garde contre les excès du maccarthysme et l’obsession anticommuniste.
Plus que la profondeur de l’analyse, c’est le style « branché » de Jean-Pierre Costes qui peut séduire par sa surabondance de références diverses ; parfois, on croirait lire les articles-fleuves parus naguère dans les Cahiers du cinéma, Les Inrockuptibles ou Libération. Il y a pourtant peu de jargon, seulement une verve et une passion sincère pour le cinéma. Le point faible du livre est sans doute d’inclure trop de réalisateurs au talent discutable aux côtés de véritables créateurs de génie. Par ailleurs, pourra-t-on apprécier ce livre sans avoir vu la plupart des (nombreux) films mentionnés tout au long de l’argumentation ? S’il est impossible d’avoir tout vu (et Costes fait quant à lui preuve d’une indéniable culture cinématographique), on suivra mieux les démonstrations si on connaît déjà bien le cinéma américain, car les films étudiés ne sont pas systématiquement résumés.
L’étiquette édulcorée de « subversion » ne signifie plus la même chose qu’à l’époque de la guerre froide. Être subversif dans l’Amérique du milieu du XXe siècle pouvait tenir de l’exploit anticonformiste. Par ailleurs, on notera l’absence d’un chapitre sur Elia Kazan : fut-il dénonciateur ou délateur dans son chef-d’œuvre Sur les quais (On The Waterfront) ? Enfin, il faut rappeler que les plus grands subversifs de l’histoire du cinéma auront été européens : Luis Buñuel, Stalan Dudow, Pier Paolo Pasolini, ou encore le Géorgien Tenguiz Abouladzé, qui avait tourné Le Repentir (1984) contre vents et marées dans une URSS qui ne supportait pas la critique du totalitarisme. Pour un panorama mondial des cinéastes subversifs, il faudrait (re)lire Le cinéma, art subversif (Buchet-Chastel, 1977) d’Amos Vogel.
LES SUBVERSIFS HOLLYWOODIENS
L’ESPRIT CRITIQUE DU CINÉMA GRAND PUBLIC
- Liber,
- 2015,
- Montréal
490 pages
40 $
Loading...
Loading...

ESPACE PUBLICITAIRE
DERNIERS NUMÉROS
DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE
Loading...