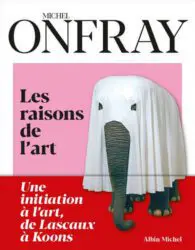L’auteur peut être selon les ouvrages et les moments tonique ou irritant. C’est la double impression que laisse la lecture de ce livre consacré cette fois-ci à la peinture, qui est comme un complément ou un appendice de Le crocodile d’Aristote. La couverture en est encore plus laide que celle du précédent : un immense drap blanc recouvre un éléphant dont on ne voit que les yeux et la trompe…
Onfray part de l’idée que l’artiste ne cherche pas délibérément à faire du beau. Il ne s’installe pas devant son chevalet en se disant : « Je vais faire un beau tableau ». Il se demande comment organiser l’espace pour y placer des personnages, comment traduire la lumière sur un paysage, suggérer le temps, comment apparier les couleurs. Cette idée qui prend à rebrousse-poil nos convictions n’est pas entièrement neuve ; Malraux avait déjà montré que la finalité de l’art était d’ordre métaphysique, en ce sens qu’elle dépasse la représentation de la réalité. L’évidence est plus grande si l’on contemple, par exemple, des masques africains ou océaniens, ou encore des statuettes évoquant des êtres humains, c’est-à-dire si l’on sort du domaine de l’art occidental, mais, dit l’auteur, même dans la peinture qui emplit les salles de nos musées, « le Beau arrive a posteriori. Il ne fut pas a priori ». L’artiste tente de saisir – ou de fabriquer – « un sens qui nous échappe » et il nous faut apprendre à le décoder tout comme on apprend une langue étrangère. Dans Le crocodile d’Aristote, Onfray démontrait brillamment comment un simple détail, un objet ou un geste livre une clef et permet de reconstituer toute une philosophie.
Dans ce livre-ci, il s’interroge sur ces mystérieuses empreintes de mains que des hommes préhistoriques ont laissées sur les parois de cavernes en divers lieux du monde. Produit d’un « élan vital », dit l’auteur, affirmation d’une présence. Hypothèse parmi d’autres énoncées depuis longtemps : l’artiste (si l’on peut risquer ici ce terme) était peut-être conscient (ou il ne l’était pas) d’accomplir un acte rituel ou propitiatoire pour que la chasse lui soit favorable, ou un acte de magie.
Il est plus difficile d’admettre que le sculpteur grec taillait dans le marbre le corps parfait d’un éphèbe ou d’une Vénus simplement sous la pulsion d’un « élan vital ». Ou que l’idéal de beauté ait été étranger à Botticelli dans son magnifique Portrait de Simonetta Vespucci, ou dans un autre portrait de la même par Piero di Cosimo, ici reproduits. En fait, l’assertion d’Onfray (qui contourne « la beauté » en parlant de « grâce », d’« édification ») n’est pas universellement valable, ni pour n’importe quelle époque de l’art, ni en toute culture. Des distinctions s’imposent : Léonard de Vinci cherchait délibérément la beauté, mais pas Brueghel ou Rembrandt. La situation est plus complexe quand on considère les miniatures médiévales ou les fresques de Giotto.
Onfray poursuit sa traversée de la peinture par un déchiffrement méthodique (et très éclairant) du portrait en pied de Louis XIV par Rigaud, et des natures mortes de Chardin, chez qui les objets acquièrent leur autonomie et « s’ouvrent vers une transcendance » (on pouvait penser que cette notion était étrangère au matérialisme professé par l’auteur ?). Étonnant que le commentateur ne se soit pas attaché à l’arrière-plan fantomatique et inquiétant constitué par une raie suspendue, preuve que parfois l’objet échappe à la saisie qui se veut réaliste…
Dans l’exposé sur ces « raisons de l’art », chaque période est placée sous un signe dominant : la grâce, le vérisme, l’allégorie, la ressemblance, le dionysiaque, etc. Puis vient l’art moderne et la recherche de la plus grande proximité du réel. Monet la trouve dans la lumière sur la façade d’une cathédrale ou sur des meules de foin, où elle devient une réalité en soi (exemples bien connus). L’évolution de l’art est résumée en formules concises où l’auteur livre le plus incisif de son analyse. Ensuite, le sujet va disparaître, « transformé en prétexte » vers l’abstraction (avec Kandinsky), puis le conceptuel avec Duchamp et sa fameuse Fontaine. Il faut avouer que pour le lecteur bienveillant, après le décodage, elle demeure ce qu’elle est : un urinoir… On aurait souhaité qu’Onfray en dise plus sur la fascination de la matière (par exemple chez Fautrier), qui n’est pas aujourd’hui une tendance isolée.
De longs chapitres sont consacrés aux arts portés par des idéologies politiques. Inévitablement le nazisme, mais fallait-il lui consacrer vingt pages d’illustrations où l’inévitable Goebbels présente au Führer l’exposition rassemblant, pour les condamner et les ridiculiser, des échantillons de « l’art dégénéré », et pourquoi ajouter des fac-similés de documents (non traduits) qui définissent les conceptions artistiques du Reich ? Par contre, l’art soviétique sous les ukases de Jdanov, réduit à une tonitruante affiche de propagande, est presque escamoté.
Plus regrettable est la présentation de l’art contemporain, qui demande des clefs insiste l’auteur en se présentant comme l’un des seuls philosophes actuels à s’intéresser à l’art. On veut le croire sur parole, car ses confrères, du moins les stars médiatisées, requises par la politique et l’état de décrépitude de la culture, ne semblent guère portés sur l’esthétique (à signaler cependant que Finkielkraut en parle dans son récent L’après littérature). Onfray cite complaisamment la liste des artistes et compositeurs qui sont ses amis et il raconte longuement une visite à Soulages (quelle chance pour lui !). Mais le lecteur qu’il s’est donné pour tâche d’instruire (on lui en sait gré) doit se contenter de noms, sans commentaires, si ce n’est plusieurs pages consacrées au seul Joan Fontcuberta, qui « interroge l’articulation entre le réel et le virtuel, le vrai et le faux, le naturel et le culturel ». Il n’est pas le seul ! Que font d’autre les artistes de notre temps ? Pourquoi ne pas nous avoir éclairés sur les tendances, les divers mouvements, leurs particularités, en joignant et en commentant des exemples visuels ? Et nous fournir des critères de valeur, car le spectateur contemporain en est bien démuni.
Cet ouvrage d’Onfray, bien qu’intelligent, souvent vigoureux et éclairant, et, comme chacun de ses livres, plein d’idées et de formulations neuves (à la différence du Crocodile d’Aristote), nous laisse sur notre faim. Peut-être a-t-il été rédigé trop vite, à moins que ce ne soit l’amorce d’un autre livre plus ample sur le sujet ? Avec Onfray, on ne sait jamais ce qu’il prépare…