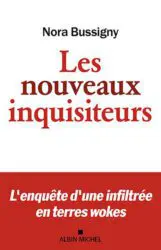Il se dit bien des choses sur le wokisme. La journaliste Nora Bussigny a décidé d’infiltrer le milieu des militants antiracistes et intersectionnels pour voir directement de quoi il retourne. Elle nous livre ici un compte rendu de cette expérience de presque un an.
Pour se préparer, l’auteure s’est d’abord documentée en lisant d’autres récits d’infiltration, dans le monde policier mais pas seulement, par exemple Steak Machine de Geoffrey Le Guilcher (sur les abattoirs) et 10 jours dans un asile de Nellie Bly. Ensuite, elle s’abonne à divers comptes militants pour se familiariser avec les idées qui y ont cours, puis s’inscrit à une première formation en ligne organisée par des féministes intersectionnelles. Elle y constate la grande efficacité du discours des hijabeuses : « Je comprends alors que leur maîtrise de l’‘agit-prop’, combinée à leur intelligence, leur permettra très certainement de gagner leur combat ».
Dès lors, elle redouble d’énergie et « engrange en quelques semaines un contenu ahurissant de podcasts » : Lauren Bastide, Alice Coffin, Paul B. Preciado, Rokhaya Diallo, tous les chantres de la déconstruction y passent, jusqu’à ébranler de nombreux a priori de l’enquêteuse.
Lorsqu’elle se sent prête, elle fait elle-même quelques publications sur Instagram afin de se donner une crédibilité dans ce milieu très sélect, puis, ayant pris soin de se donner un look crédible, se présente à une première réunion en personne. Elle entre alors dans un monde où l’intolérance, le jugement moral, l’intransigeance, le sectarisme, le racisme inversé, les préjugés et la haine des hommes blancs cis sont érigés en normes.
Une de ses expériences les plus marquantes se produira lorsqu’elle se portera volontaire pour participer au service d’ordre de la pride radicale, une marche de la fierté LGBT+ menée en parallèle de la marche traditionnelle, celle-ci étant jugée trop capitaliste par certains groupes. Pour cette marche, il est décidé que la non-mixité sera de mise. Cela signifie notamment que les cisgenres, considérés comme essentiellement oppresseurs, doivent défiler séparément des transgenres. Malheureusement, il n’est pas toujours évident de départager les uns des autres (!), et il faudra donc à un certain moment assouplir l’interdiction. Notre journaliste furtive verra alors une organisatrice « écœurée que le cortège des transgenres soit finalement autorisé aux personnes cis. Comme quoi, la mixité et le vivre-ensemble ne semblent pas être l’apanage de la pride radicale 2022… ».
Heureusement, par contre, distinguer les racisés des Blancs, c’est plus facile. Nora Bussigny a d’ailleurs la chance d’être d’ascendance maghrébine, et c’est pourquoi sa présence dans le service d’ordre ne pose pas de problème. Quelle est la consigne qu’elle devra appliquer ? Simple : demander aux Blancs d’aller derrièreafin de laisser la tête du cortège aux personnes racisées (en cachant leur action aux policiers, car ce genre de mesures est raciste, donc illégal). Lorsqu’elle s’exécute auprès d’un joyeux groupe d’amis composé à la fois de personnes racisées et de « deux jeunes roux à la peau ivoire », dont l’un est « affublé d’un drapeau LGBT », celui-ci demande : « Mais je ne sais pas si je suis racisé, moi, ça veut dire quoi ? » Notre infiltrée, ayant bien assimilé un vocabulaire qu’elle entend à profusion depuis quelques mois, sait quoi répondre : « As-tu déjà vécu du racisme ? Si non, cela veut dire que tu n’es pas une personne racisée et cet espace est un lieu safe en non-mixité ». L’amie du jeune gay hébété répondra pour lui : « Pardon, désolée pour lui, on s’en va ! »
Ce qui la frappe, c’est d’abord la docilité des Blancs, qui font preuve d’une « soumission […] immédiate, inquiétante ». Puis, c’est sa propre intolérance à elle devant les rares cas où ils rouspètent. Elle se rend compte alors que le conditionnement fait effet : elle commence à être foncièrement convaincue que les Blancs et les cisgenres (hétéros ou gays) n’ont plus aujourd’hui que le droit de se taire et d’obtempérer.
D’ailleurs, les effets psychologiques de cette immersion seront tels qu’elle rencontrera un psychanalyste à quelques reprises ; les séances sont enregistrées, et leur compte rendu fait partie intégrante de l’ouvrage. La journaliste y avoue que, absorbée par le discours transgenre, elle en est venue à se demander « comment savoir si je suis une femme ? », alors que cette question ne lui avait jamais traversé l’esprit avant.
Malgré ces constats sans équivoque, l’auteure confie à son psy, en conclusion : « C’est vrai qu’au début du livre, je me trouve trop péremptoire […] ». Mais son but était de « livrer à tous les lecteurs une caméra, afin qu’ils voient avec [s]es yeux ».