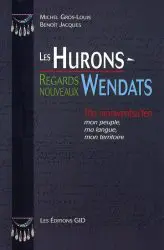« […] dans la quête de mon identité, je me suis rapidement rendu compte que la culture et la spiritualité du peuple Wendat ne pouvaient être vécues et comprises sans la connaissance de notre langue », écrit Michel Gros-Louis.
Dans leur premier essai conjoint regroupant une série de conférences, les linguistes Michel Gros-Louis et Benoît Jacques explorent une langue pratiquement disparue depuis 90 ans : le huron. La situation linguistique des Premières Nations s’est considérablement aggravée : « À l’arrivée des Européens au Canada au XVIIesiècle, quelque 170 langues étaient parlées par les Autochtones. De ce nombre, seulement 60 sont toujours vivantes ». Cet essai rappelle des distinctions notables entre les différents peuples autochtones : par exemple, les Hurons-Wendats, qui « entretenaient un lien d’amitié depuis toujours avec toutes les nations au contraire des Hurons-Pétuns ».
À ne pas confondre avec le livre-bilan Les Wendats du Québec. Territoire, économie et identité, 1650-1930 (GID, 2013) d’Alain Beaulieu, Stéphanie Béreau et Jean Tanguay, ces « regards nouveaux » sur les Hurons-Wendats veulent resituer cette nation à la recherche de son identité perdue. Non, le monde autochtone du Canada ne forme pas un bloc monolithique : chaque nation possède son nom et sa culture, sa langue et ses traditions. Michel Gros-Louis et Benoît Jacques réussissent à faire revivre momentanément les Stadaconiens, mais aussi d’autres peuples comme « les Oneidas, les Cayugas, les Senecas, les Onondagas et les Tuscaroras », qui ont tous fait partie de « la famille linguistique iroquoienne du Nord ».
Tout le deuxième chapitre rectifie et corrige les équivalents entre la langue huronne et le français, tels qu’ils auraient été transcrits initialement par Jacques Cartier, en 1545, dans un lexique bilingue de 104 mots de base : « […]les parties du corps, les chiffres de 1 à 10, la nature, les vêtements et quelques verbes ». Avant Jacques Cartier, la langue huronne n’avait jamais été écrite. Quelques tableaux comparatifs fournissent des exemples de mots traduits en langue crie (de la famille algonquine) et en langue wendate (de la famille iroquoienne) avec des équivalents en français. Si l’iconographie de ce livre abonde, on reprochera cependant aux auteurs de ne pas avoir indiqué systématiquement les dates, même approximatives, des images et de leur contenu ; ainsi, on voit au début du premier chapitre une « maison longue iroquoienne », mais de quand date cette maison (ou cette réplique) ? Et de quand date cette photo ?