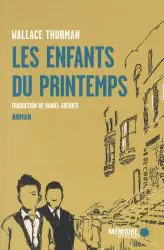Décédé à seulement 32 ans (en 1934), Wallace Thurman s’inscrit dans le mouvement Renaissance de Harlem, qui fut populaire durant l’entre-deux-guerres aux États-Unis. Pendant cette période, apprend-on, la culture noire a joui d’une certaine popularité dans les cercles intellectuels américains, où l’affirmation de son identité s’est confondue avec la lutte pour l’égalité raciale et la justice sociale.
Auteur connu de cette mouvance, Thurman a livré quelques écrits, qui forment une œuvre assurément très inachevée, car il a été fauché dès son jeune âge par une maladie du foie associée à une consommation excessive d’alcool.
Dans ce récit où l’on sent très bien qu’il emprunte beaucoup à sa vie personnelle, il raconte l’histoire de jeunes bohèmes, principalement noirs, tous attirés par l’art (littérature, musique, peinture).
Ces jeunes, dont Raymond, l’écrivain du groupe, se croisent régulièrement au manoir Niggeratti, en plein Harlem, résidence soutenue par une philanthrope désirant appuyer l’expression de la culture noire. Les « sessions » impromptues de ces jeunes dont certains pêchent par idéalisme, d’autres, par pur cynisme, produisent des discussions animées, qui se concluent par des beuveries au gin faisant finalement bien peu avancer la cause de la culture noire.
Toutes les questions autour de la place des Noirs, de leurs rapports aux Blancs et de leur propre sentiment envers eux-mêmes traversent le fil du roman. On y sent très bien le tâtonnement d’une culture qui veut émerger et se créer une place entre le retour promu par certains à la tradition africaine et l’expression préconisée par d’autres d’une individualité assumée, hors du lourd tribut imposé par la dure ségrégation qu’a dû subir la communauté afro-américaine.