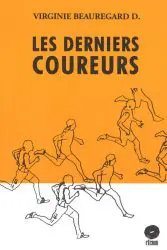Les mots d’Haruki Murakami annoncent la couleur, comme un appel à l’émerveillement dans un quotidien aux contours que l’on connaît trop bien.
On s’éveille, dès les premières pages des Derniers coureurs. La narratrice a le ton grave. Elle tire du sommeil comme elle tire sur les manches. Le regard se déplace, peut-être pour ne pas s’abandonner au gris, au terne, à la course effrénée : « [A]lors je tire sur ta manche / il faut aller vers la surface des choses / chercher / quelques traits de lumière ». L’écriture est minimaliste, dépouillée et pourtant percutante. Elle ouvre mille portes dans l’esprit du lecteur, ce qui fait qu’on ne peut déposer le livre. Les images de Virginie Beauregard D., si brèves soient-elles, trop brèves parfois, envoûtent. Elles collent à l’esprit. Il faut la lire, y revenir, pour goûter la richesse, la force de frappe de sa poésie.
On retrouve des couleurs de fin du monde dans les poèmes, une vision à la fois clairvoyante et décalée des choses, un angle qui est là depuis le premier livre de l’auteure, Les heures se trompent de but, paru chez le même éditeur en 2010. Avec ce nouveau titre, l’œil est plus acéré, la beauté émerge de la laideur, de l’ennui, l’élégance côtoie le vulgaire. Il y a de l’épuisement dans ce livre et de la splendeur dans la fatigue. La tranquillité est menacée. Alors on espère, on s’acharne, on se brûle, sur une plage, un sentier, au milieu des coureurs, dans une somnolence feutrée. Comme dans les deux livres précédents, des dessins de l’auteure accompagnent les poèmes. Le trait est un souffle en mouvement, brut et affirmé. Ces apparitions nous portent un peu plus loin dans l’imaginaire singulier de Beauregard D.
La lecture des Derniers coureurs est un songe. La frontière entre la vie éveillée et le sommeil est constamment mise en scène : dormir comme se réfugier, comme oublier, dormir comme source d’angoisse par moments. De texte en texte, la poète vole, dérobe ce qui lui fait envie, des pépites de joie à la noirceur. Parce que rien ne sera donné, il faut prendre, à pleines poignées. Entre rêve et état sauvage, torpeur, douceur, sensation de vide, on avance, à proximité de la narratrice qui tombe, se relève. L’intimité peut être étouffante, les sentiments, confus, comme s’ils revêtaient différents visages : « [P]enchés / sur les bandeaux / des derniers coureurs / nous réanimons / les braises / qui persistent ». Le nousest solide, infatigable malgré la douleur, l’anxiété et la détresse. Le livre est physique et organique, le corps y est partout : en mouvement, sportif, animal.
Alors que la tentation d’aller vers le brut est là, dans un univers mécanisé, aseptisé, il y a parfois une sorte de déconnexion avec le côté naturel, un peu homme des cavernes : « [C]omme des idiots / nous éliminons la cueillette / et la survie ». Enfin, ça brille dans Les derniers coureurs : on y parle d’éclat, d’étoile, d’étincelant, d’éclairs et de flamboyant, et tout ce lexique vient illuminer la tourmente. Le lecteur se fond dans cet univers, se confond ; tout est lié et chaque émotion a son écho, son contraire. Y résonne une profonde vérité. Entre avancer ou rester là, courir ou se jeter à l’eau, vivre ou dormir, moi, je suis restée captive de ces mots : « [J]e ris comme je pleure / mais ce n’est pas laid / ce n’est que le principe / du jour et de la nuit ».