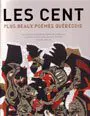Cette anthologie qui nous offre un vaste panorama de notre histoire littéraire, de notre poésie en particulier, est, de fait, très « stylisée » comme « objet culturel » – pour reprendre l’expression de Fernand Dumont. Et, comme le mentionne Pierre Graveline dans sa brève présentation, cette poésie est partie prenante de l’« imaginaire de l’humanité », de son « patrimoine culturel ». On n’a qu’à penser au fait qu’elle est traduite dans de nombreuses langues : L’homme rapaillé de Gaston Miron, par exemple, serait édité tant en anglais, en italien, en espagnol, en portugais qu’en coréen…
II n’y a donc pas à douter que le Québec est une « terre de culture »… et que celle-ci se situe au fondement – avec le roman et le cinéma, entre autres formes culturelles – d’une identité qui a longtemps été exprimée bien avant nos avancées économiques et politiques ou, à tout le moins, avec un impact similaire si l’on se place à l’orée de la révolution dite « tranquille ». Très ancrée localement, notre culture contient et projette, à la fois, des thèmes universels inscrits dans un immense patrimoine culturel mondial. La poésie québécoise, croyons-nous, émerge de la symbiose d’un malaise existentiel, d’une fureur d’« être-là », d’une forte critique sociale et, souvent, d’un engagement politique toujours exprimé avec un grand souci esthétique.
On peut, également, parler d’une « continuité » dans notre culture – en poésie dans le cas de ce volume. Il est ainsi possible de « passer » des textes de Louis Fréchette à ceux de Nelligan jusqu’à Gaston Miron, Paul Chamberland, Michèle Lalonde, Gilbert Langevin et aux auteurs plus « récents » et cela, sans ressentir de rupture importante. Il est vrai que notre culture est jeune, et qu’elle s’est développée rapidement dans les années soixante et soixante-dix. Elle comporte conséquemment des « traversions » comme effets de « sens », reliant créativement l’existentiel à l’esthétique… Cette anthologie reflète bien ce phénomène.