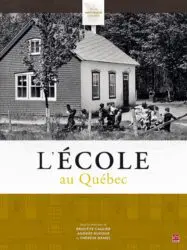Dans la magnifique collection « Atlas historique du Québec », les Presses de l’Université Laval viennent de publier L’école au Québec, un monument de près de 500 pages grand format dressant un panorama complet de notre histoire scolaire, depuis les débuts du Régime français jusqu’à l’aube de la Révolution tranquille.
On ne peut que lever son chapeau devant une telle œuvre. Sur le plan matériel d’abord : papier couché, typographie soignée, mise en page artistique, riche iconographie représentant bâtiments et acteurs du monde scolaire (enseignants, élèves) mais aussi documents d’époque – rapports, documents gouvernementaux, manuels – qui nous font toucher du doigt le passé.
Il faut souligner de plus la multiplicité des collaborateurs et l’exhaustivité du champ d’examen, qui traite évidemment de la majorité canadienne, puis canadienne-française, mais accorde aussi une place de choix aux minorités, qu’il s’agisse des anglo-protestants, des anglo-catholiques, des juifs, des immigrants ou des Autochtones.
L’ouvrage se compose de textes autonomes de longueur moyenne répartis en six grands chapitres : 1o « De la petite école au système scolaire » ; 2o « Scolariser les enfants des minorités et des Autochtones » ; 3o « L’école primaire : lieu d’enseignement et d’éducation » ; 4o « Le corps enseignant » ; 5o « La formation au secondaire et les passerelles vers l’université » ; 6o « Répondre aux besoins du monde du travail ». À la lecture de chaque section, on saisit sans peine le travail de moine qu’il a fallu pour colliger des données (fréquentation scolaire pour chaque clientèle, nombre d’écoles de tel ou tel type et leur emplacement, tableau des programmes au fil des époques) dans un secteur en mouvance constante qui ne se laisse pas appréhender si facilement. Cartes et diagrammes, nombreux et détaillés, témoignent de ce travail colossal. Il ne faut toutefois pas se laisser tromper par l’appellation « Atlas » : il s’agit bel et bien d’un ouvrage composé essentiellement de textes explicatifs.
On entre à l’école à six ans, et on ne se pose pas de questions sur la structure qui nous est imposée ni sur la matière qui nous est enseignée. Mais une fois adulte, on constate à quel point ces questions représentent pour une société des défis constants engendrant débats et divisions sans fin. L’école, dans le Québec d’avant la Révolution tranquille, a invariablement été sous-financée par une société qui ne considérait pas l’instruction comme une valeur cardinale. Dans le monde francophone à tout le moins, car les anglo-protestants, dès leur arrivée après la Conquête, ont valorisé l’apprentissage de la lecture, ne serait-ce que comme moyen privilégié d’étudier la Bible, mais aussi parce que les débouchés professionnels étaient plus évidents dans ce milieu qui dominait l’économie et la politique. Il faut dire aussi que le mode de financement, essentiellement local pendant la période étudiée, favorisait ce groupe, qui bénéficiait d’une assiette fiscale plus importante même s’il était minoritaire, en raison de ses possessions foncières et de sa richesse générale.
Seul bémol à l’égard de cette œuvre de facture exemplaire : la propension agaçante de certains auteurs à juger du passé à partir de critères actuels, en mêlant les jugements de valeur à une description des faits qui gagnerait à être davantage présentée en fonction des ambitions authentiques de nos ancêtres, dans le contexte de leur époque et de leur mentalité, que dans l’optique téléologique de nos grilles d’appréciation du XXIe siècle. Par exemple, on pourrait arguer qu’en présentant le cours classique comme « unique école de la domination », on utilise un vocabulaire anachronique trahissant les idéaux qui animaient les agents de cette filière, et qu’une reconnaissance de l’apport de ce cours à la société canadienne-française par ses valeurs d’excellence (sans nécessairement passer sous silence les reproches commençant à poindre au milieu du XXe siècle), en prenant de la hauteur par rapport au dédain actuel pour l’élitisme, rendrait peut-être davantage justice à l’esprit de notre passé. On peut en dire de même du rappel constant – parfois simple constat objectif, mais parfois aussi accompagné de la petite musique du jugement moral – du fait évident que la formation des filles, du XVIIe siècle au milieu du XXe siècle, n’avait pas la même finalité que celle des garçons. Heureusement, bien que cette tendance affleure de temps à autre, elle ne remet pas en cause la qualité de l’ensemble, et encore moins la valeur des précieux faits statistiques présentés.