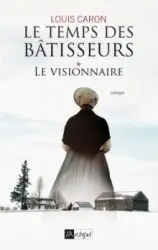Louis Caron revient sur la scène littéraire après un silence d’une dizaine d’années. Le visionnaire amorce aujourd’hui sa troisième trilogie, Le temps des bâtisseurs, où l’auteur se propose de mettre à profit les sept ancêtres architectes figurant dans son arbre généalogique paternel. Il ne s’agit toutefois « pas […] de biographie », mais de « pure création littéraire » et de « vérité réinventée », précise-t-il dans un court texte autobiographique liminaire.
Le visionnaire raconte essentiellement les aventures et mésaventures du quadragénaire anticonformiste Frédéric Saintonge qui, au milieu du XIXe siècle, vit dans le village de L’Islet-sur-Mer, le long du fleuve Saint-Laurent. Fermier, constructeur de goélettes et caboteur avec son fils homonyme qui, lui, est attiré par le dessin, Frédéric est marié à Géraldine mais entretient depuis plus d’un an une relation illicite avec Francine, la femme de son fainéant et brutal frère Félicien, dont la terre jouxte la sienne. Il aura une double confrontation avec des hommes d’Église. Le curé de son village bas-laurentien, l’abbé Cyprien Desnoyers, l’accuse d’abord du haut de la chaire du détournement de la bienveillance divine sur la paroisse à cause de sa conduite de libre penseur. Frédéric lui rétorque sur-le-champ, devant tous les fidèles, en l’accusant à son tour de profiter « de ce qu’il entend au confessionnal pour attirer des femmes dans son presbytère ». Il quitte dès lors l’église et l’Église. Devant le commérage des paroissiens et la pression générale, Frédéric laisse bientôt L’Islet-sur-Mer pour une expédition à l’île d’Anticosti avec son fils. Après un naufrage non accidentel qui le ramène à son village, il part au printemps suivant, toujours accompagné de son fils, pour Sainte-Anne, une paroisse canadienne-française de colonisation en Illinois, dans le Midwest américain, où le curé Jean-René Quintier recrute des bras pour son développement. À son arrivée, il est vite surpris par la grogne qui sourd de la communauté divisée entre les partisans et les adversaires de ce prêtre autoritaire, abusif, impatient et rusé. Celui-ci provoque au surplus l’ire de son évêque par sa désobéissance, ses gestes criminels (on l’accuse d’avoir incendié une église) et son entêtement à suivre une religion personnelle. Un procès ecclésiastique est d’ailleurs en cours, au terme duquel il sera excommunié. Les relations entre Quintier et les deux Saintonge s’enveniment rapidement. Le frère Régis, Français d’origine et directeur de l’école des garçons, intervient à plus d’une reprise en faveur des deux nouveaux arrivants. Après une poursuite judiciaire intentée puis perdue par l’abbé, le père va retrouver son fils à Chicago, où un architecte l’a engagé. Avant de rejoindre son amant, Francine a « arrangé les choses au mieux » avec Géraldine à propos de leurs dix-sept enfants, pour que « chacune y trouve […] son compte et fini[sse] par faire son bonheur ».
Le visionnaire intéressera sans doute les amateurs de romans traditionnels, au déroulement simple et aux personnages bien définis dans leur attitude stable, jusqu’au happy end. Le tout se déroule au gré d’une phrase à la structure tout aussi simple, parfois de forme nominale et à connotation métaphorique maritime de bonne venue. On note le rôle d’informateur, au sens ethnologique du terme, que se donne le narrateur en faisant état des us, coutumes et dictons de l’époque choisie : l’usage du « banc du quêteux », le calfeutrage des fenêtres en hiver et le fauchage des herbes salées sur les battures du fleuve en sont quelques exemples. Sur le plan historique, on n’est pas sans remarquer la ressemblance entre le personnage du curé Quintier et le prêtre québécois Charles Chiniquy (1809-1899), célèbre en son temps pour son inclination vers les femmes, son apostasie de la foi catholique, son adhésion à l’Église presbytérienne de Chicago et sa double excommunication.
Si la diégèse (l’histoire) se déploie pour ainsi dire en douceur, dans une langue honnête et correcte, il n’y a rien de transcendant ni de particulièrement novateur malgré l’affirmation racoleuse de la quatrième de couverture, où l’éditeur présente le roman comme « une fresque au souffle romanesque incomparable ». Le visionnaire n’est pas une œuvre minimale pour autant, mais le lecteur éprouve un certain agacement devant les redites diégétiques (parfois triples) et la propension à accumuler les détails explicatifs ou descriptifs.
ESPACE PUBLICITAIRE
DERNIERS NUMÉROS
DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE
Loading...