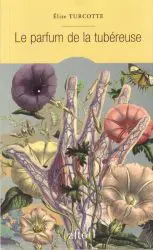On pourrait lire cette fable comme une attaque contre l’autoritarisme, l’utilitarisme aveugle qui sévit actuellement en éducation. Une attaque sentie, sensible, comme le fut, à une autre époque, celle que George Orwell livra contre le totalitarisme avec La ferme des animaux, satire du stalinisme et des dérives d’un régime aveuglé par la recherche du pouvoir, par son obstination à vouloir faire taire toute voix discordante. Là s’arrête la comparaison, volontairement grossie, mais les événements d’un passé récent et ceux qui pourraient bien se (re)produire dans un proche avenir risquent de l’amincir, de nous rappeler que si tous les citoyens sont égaux, les tenants du pouvoir le sont toujours un peu plus que les autres.
Pour avoir refusé de donner ses cours à un groupe d’étudiants qui se réclamaient du droit à les recevoir, Irène, après avoir rejoint ceux et celles qui clamaient dans la rue le droit à une éducation gratuite, se voit convoquée par la direction du collège, où elle enseigne la littérature, à venir justifier sa participation à une grève décrétée illégale sitôt après avoir été votée. La convocation est tout aussi ubuesque que le verdict sans appel qui s’ensuit : Irène, qui refuse de se soumettre, est renvoyée. La fable se met en branle, la charge choisit ses armes. Irène se retrouve dans un bunker, condamnée à enseigner la littérature à un groupe d’élèves qui, comme elle, a voulu croire à un monde meilleur, un monde où il est possible d’exprimer ses rêves, où non seulement on vous invite à le faire mais dans lequel le rôle des enseignants est de vous outiller pour y parvenir et de vous ouvrir à des perspectives jusque-là inaccessibles, inconnues. Faisant écho à une autre situation tristement d’actualité, Irène ne peut emporter avec elle qu’un seul livre, Dialogues en paradis de Can Xue, dans ce bunker où se transposent les rivalités professionnelles. Qu’à cela ne tienne, Irène en affûtera chacun des mots pour en aiguiser le sens et l’offrir à ses étudiants, leur permettant ainsi d’ouvrir leur conscience et de les amener à libérer leur propre parole, comme la plante éponyme qui libère une fragrance enivrante, un parfum qu’on ne peut oublier dès qu’on l’a humé : « Can Xue a écrit sur une fleur de nuit : je fais appel à la mémoire des sens pour que la poésie soit manifeste. Ainsi, pour mes élèves, je reconstruis l’instant de la découverte ».
Le récit d’Élise Turcotte est tout à la fois empreint de colère et d’espoir, de dénonciation et de poésie. Un récit qui emprunte par moments à la littérature gothique des motifs pour mieux circonscrire l’univers concentrationnaire ici dénoncé, et qui se réclame aussi du discours poétique pour opposer aux diktats de l’heure l’espoir qu’une fois libéré le parfum de la liberté ne puisse être de nouveau enfermé dans une fiole et remisé hors de la vue, hors de portée. La lecture de cette fable, pour singulière qu’elle soit, est avant tout plurielle. Elle appelle à la relecture. « Les parfums, tout comme les livres, ne sont-ils pas des silhouettes de chats qui traversent les couloirs bien après leur disparition ? C’est ce que j’affirme en tout cas », nous dit Irène. Et bien après qu’elle s’est tue, sa voix nous accompagne comme cette chanson, « Porque te vas », extraite du film de Carlos Saura, Cría Cuervos, comme pour nous rappeler que l’espoir finit toujours par exhaler son parfum. Et nous rester en mémoire.
ESPACE PUBLICITAIRE
DERNIERS NUMÉROS
DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE
Loading...