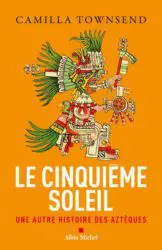De tout temps, l’histoire a été écrite par les vainqueurs. Il n’en fut pas autrement des guerres de conquête qui ont vu les Occidentaux débarquer en Amérique aux XVe et XVIe siècles. Camilla Townsend, historienne à l’Université Rutgers, spécialiste de l’Amérique précolombienne, entend corriger ce biais culturel en tentant une histoire des Aztèques, telle qu’on peut la déduire des écrits qu’ils ont laissés.
Cette réputation a longtemps résumé l’essentiel de ce que l’on sait sur les Aztèques, présentés dans l’historiographie espagnole comme un peuple sanguinaire et cruel du fait de leur pratique du sacrifice humain. Comme tout cliché, l’auteure nous fait savoir que, même si elle contient sa part de vérité, cette image est réductrice.
Sans nier la brutalité de certaines traditions aztèques, Le cinquième soleil apporte des nuances et une contextualisation qui atténuent la cruauté associée a la culture aztèque. Par exemple, elle nous dit que les sacrifices humains n’étaient pas au cœur de leurs préoccupations. Ainsi pouvaient-ils se montrer cruels le matin envers un esclave et bienveillants le soir après leur journée de travail dans les champs, car ils étaient à la fois guerriers et agriculteurs.
Probablement venus du Nord-Ouest américain, descendant de l’ethnie chichimèque, les Aztèques, fuyant la famine, furent le dernier peuple à s’installer sur les terres fertiles de l’Amérique centrale vers le début du XIVe siècle. De ce fait, ils furent confinés sur une île marécageuse au milieu du grand lac Texcoco (aujourd’hui disparu). Ils y bâtirent leur capitale, Tenochtitlan, aujourd’hui Mexico.
Un siècle plus tard, ils étaient devenus l’ethnie la plus puissante et également la plus plus avancée de celles qui peuplaient l’Amérique centrale. À l’arrivée de Hernán Cortés et des conquistadors espagnols en 1519, ils furent pourtant parmi les premiers à se soumettre à une espèce d’assimilation volontaire en adoptant l’alphabet latin des conquérants, leurs méthodes de construction des édifices aussi bien que des navires, une certaine forme de gouvernance, etc.
Eux qui avaient bâti leur propre hégémonie sur la force, ils étaient en mesure de reconnaître la supériorité militaire des nouveaux arrivants et d’accepter la loi du plus fort. Ce qui d’une certaine manière protégea leur culture jusqu’à aujourd’hui. En effet, encore maintenant plus d’un million de personnes parlent le nahuatl, la langue d’origine des Aztèques.
Après la Conquête de 1519, après qu’on leur eut appris l’alphabet européen pour faciliter leur apprentissage de la Bible, des jeunes entreprirent de noter les légendes et l’histoire de leur peuple. C’est donc paradoxalement grâce à l’envahisseur que les Aztèques purent garder vivantes à la fois leur langue et leur histoire.
En dépit de toutes ses qualités – le livre a mérité le prix Cundhill History Prize –, on ne pourrait pas recommander Le cinquième soleil à qui cherche un premier contact avec la civilisation aztèque. Le parti-pris de l’auteure d’appuyer principalement son propos sur la documentation nahuatl, éparse et fragmentaire, y est sans doute pour quelque chose.
En outre, le manque de précisions sur la migration des Aztèques depuis le Nord, la complexité de la généalogie de leurs dirigeants et de leurs traditions successorales, la difficulté de s’y retrouver dans la répartition des ethnies sur le territoire pour comprendre le jeu des alliances et des conflits rendent Le cinquième soleil difficile d’accès a qui n’a pas de connaissances préalables sur la civilisation aztèque. Pour lecteur averti donc.