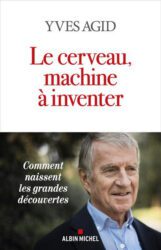Le général de Gaulle, qui ne manquait pas d’humour, aurait dit un jour à propos des scientifiques : « Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche ». Cette boutade, rapportée par l’auteur, illustre à sa façon la difficulté à laquelle feront face les jeunes qui souhaitent se consacrer à la recherche. C’est pour lui une façon de leur faire savoir que cette voie se révèle un long chemin ardu ne menant pas toujours où l’on souhaiterait aller.
D’entrée de jeu, Yves Agid distingue entre innovation, invention et découverte. La première, nous dit-il, relève de l’ingénierie ayant une finalité pratique et la seconde ne requiert pas l’existence d’objet préalable, elle peut naître plus ou moins spontanément. Quant à la découverte, elle « survient habituellement après une longue période d’incubation, non consciente, qu’on appellera subconsciente pour la distinguer de l’inconscient freudien ». Alors, quelles sont les phases qui se succèdent dans le processus de la découverte, se demande l’auteur.
Tout commence par l’étonnement, qui suscite à son tour la curiosité. Le reste n’est que suite d’essais, d’erreurs, de persévérance, de doute, de vérification, de validation, de chance et de talent. Pour faire un bon chercheur, entre autres traits de caractère, il faut, nous dit l’auteur, un esprit éveillé, curieux, une flexibilité intellectuelle, une grande capacité de raisonnement, de l’imagination, une capacité d’anticiper et de la sensibilité car « le scientifique a quelque chose de l’artiste. Tous deux imaginent tant et plus ».
Les courants scientifiques ambiants et les progrès technologiques du moment jouent également un rôle majeur dans la découverte. Si le télescope a permis à l’astrophysique de se développer et le microscope, de donner naissance à la biologie cellulaire, l’arrivée de l’ordinateur et de l’intelligence artificielle laisse aujourd’hui entrevoir des percées encore plus spectaculaires dans notre compréhension du vivant et de la réalité qui nous entoure. « Il est admis qu’Homo sapiens a plus contribué à la science au cours du dernier 1 % de son existence que pendant les 99 % qui précèdent », avance l’auteur.
Professeur émérite de neurologie et de biologie cellulaire, Yves Agid, comme le Général, ne manque pas d’humour lui non plus. À preuve, l’amusant chapitre consacré aux personnalités-types du chercheur, dont il brosse le portrait d’un trait de plume. Il y dépeint notamment l’érudit ennuyeux, l’hurluberlu ingérable, le mégalo insupportable, le compulsif agaçant, le théoricien visionnaire et le startuppeur nouveau riche.
Enfin, Yves Agir a pris grand soin de ne pas jargonner, ce qui rend la lecture de son essai très accessible aux non-initiés. Pour en rendre le contenu encore plus près du lecteur, il émaille sa démonstration de courts textes comme autant de vignettes qui racontent les circonstances de telle ou telle découverte ou une anecdote se rapportant à un grand scientifique. Ces points d’ancrage dans la réalité concrète ajoutent à l’intérêt de son opus, Le cerveau, machine à inventer, conseillé à tous ceux et celles qui s’intéressent à la démarche scientifique.