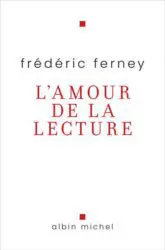Court essai, brillant et caracolant sur les jouissances de la lecture, et aussi sur celles de l’écriture. Il s’inscrit dans la lignée de ceux qui en ont fait l’éloge. On rencontre ainsi Montaigne – ou plutôt on part de lui –, Stendhal, Proust, Valery Larbaud, Rilke, Blanchot ou Barthes.
On imagine Frédéric Ferney plongé dans les livres et enivré de littérature. Sa biographie nous dit qu’il est agrégé de lettres, chroniqueur de radio, de revues et de journaux ; on découvre sans surprise qu’il a été dans le jury du Prix du style. De style, il n’en manque pas, il est même un virtuose de l’écriture !
Pas de théorie ici, pas d’exposés, de pédantisme. Parfois, l’auteur interpelle son lecteur mais sans provocation, simplement pour attirer son attention, ni écart de langage : on reste ici entre gens de bonne compagnie (l’auteur se permet cependant un peu plus de liberté dans les dernières pages, et un propos un peu plus audacieux).
Ferney nous entretient de ses lectures d’enfance, chapitre – que chacun pourrait, moins le style, écrire – inséré dans un retour nostalgique sur sa jeunesse, et d’une verve narrative inspirée et de bon aloi. De ses voyages aussi : pas de surprises là non plus car, depuis Homère, voyage, écriture et lecture ont partie liée.
Chicanons un peu l’auteur… Devant pareil déploiement de virtuosité sans cesse relancé, le lecteur peut se dire : « Trop, c’est trop ! ». Ferney n’est certes jamais banal, mais on pourrait lui reprocher certaines facilités. Celle, par exemple, qui consiste à fabriquer une formule selon l’un des procédés favoris des revues à la mode. Une phrase commence par un verbe, par exemple voyager, puis suivent d’autres verbes, à choisir entre décrire, vivre, aimer, etc. Passons, chaque écrivain (et chaque lecteur…) a ses faiblesses !
L’auteur termine son tour d’horizon par des coups d’œil sur Molière, Conrad, Camille Claudel (une fort belle lettre imaginaire) et un entretien (également imaginaire) avec Philip Roth. Brillant, comme tout ce qui précède, mais on ne sait trop quel lien unit ces propos et à quelle nécessité ils répondent au regard de l’ensemble.
Par contre, est considéré à bon escient le rapport entre la littérature et la peinture. Il mériterait plusieurs livres, mais ce n’est évidemment pas le lieu de s’attarder. Versons au crédit de l’auteur ces multiples regards de côté qui ouvrent la réflexion. Tout l’essai conduit inévitablement à la question : qu’est-ce qu’un écrivain ? Elle déclenche un nouveau feu d’artifice ! « Eh bien ? Quelqu’un qui vous emmène là où vous n’avez pas envie d’aller. Un cicerone obstiné. Un joueur de flûte. Un charmeur de rats. Un charlatan ? Et cela, grâce à la suprématie aberrante d’une forme ou d’un style – ‘cette manière d’épauler, de viser, de tirer vite et juste’ : dit Cocteau, ‘[u]ne manière absolue de voir les choses’, décrète Flaubert soucieux de s’affuter… »
La lecture, on le sait d’expérience, tend à diriger le regard de celui qui la pratique vers lui-même, elle l’intériorise. Certes, mais il faudrait ajouter qu’elle peut aussi l’aliéner, le distraire au sens fort, distendre son lien avec la réalité. Pensons au vaillant et pitoyable Don Quichotte, qui croyait revivre les faits d’armes racontés par les romans de chevalerie.
Superficiel, pourrait-on dire de l’essai de Ferney ? Non, tonique. L’auteur, artiste de haute école, fait un dernier tour de piste pour saluer le public, qui est ravi. Mais nous avions presque oublié que la littérature est aussi chose grave.