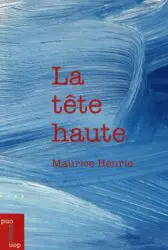Mini-inventaire de l’état et de l’histoire de notre monde à travers les yeux d’un honnête homme de la vallée outaouaise. Il s’agit en effet d’un recueil de 24 « essais » sur des sujets divers.
L’auteur aime la plume, c’est d’ailleurs un thème qui revient deux ou trois fois. Après un premier temps, dans sa vie, alimenté par la passion des livres et des mots, il est passé à une deuxième phase plus sportive et manuelle, pour ensuite revenir à ses « anciennes amours, comme l’enfant prodigue de l’Évangile rentra au logis paternel ». Il s’est alors adonné à son « ivresse verbale ». Car « une fois qu’on découvre ce penchant en soi-même, peut-on refuser de dire ou, si l’on veut, d’écrire » ?
Il nous livre donc ses idées au fil de son inspiration – même s’il n’aime guère ce mot : « Ne me parlez surtout pas d’inspiration. Ce vieux mot galvaudé que trop de gens interprètent comme une fièvre ou comme une transe. […] L’inspiration ne m’inspire pas. Ou si peu. L’intention et la réflexion m’inspirent bien davantage ». Il aborde par exemple le thème de la guerre, qui semble le lot inévitable du genre humain, celui de l’art, avec le caractère insaisissable de la valeur de telle ou telle œuvre, ou celui de la religion, avec laquelle l’auteur garde une saine distance, de toute évidence mal à l’aise avec l’irrationnel, bien qu’il soit prêt à lui manifester un respect mesuré. Certains thèmes sont plus existentiels, comme la mort, le destin ou encore la crise du mitan de la vie qui nous pousse parfois à faire des folies… jusqu’à ce qu’on se rende compte qu’on ne change pas sa nature profonde ; sans parler des spéculations plus éthérées sur l’existence de mondes parallèles.
Il ressort de l’ensemble des textes une bonne culture générale qui s’étale sous plusieurs formes, et aussi un certain cynisme face à notre monde, à ses valeurs et à ses perspectives. L’auteur, qui connaît de l’intérieur les hautes sphères de la fonction publique fédérale, ne craint pas de dénoncer les absurdités, les incompétences voire la mauvaise foi des hautes instances administratives et politiques. Il rappelle dans cette veine le scandale des sous-marins usagés achetés par le Canada à l’Angleterre en 1998, et toujours en cale sèche en 2012 après 3,3 milliards de dollars en coûts de réfection, ou encore celui du registre des armes à feu, qui a englouti deux milliards avant d’être abandonné au bout de dix-sept ans, sans parler de la propension des décideurs à contourner – assez facilement et sans beaucoup de scrupules – les règles d’embauche, de sélection ou de promotion dans l’administration, par exemple.
L’histoire du Canada et le sort de sa population francophone lui tiennent particulièrement à cœur, ne serait-ce qu’à titre de Franco-Ontarien. Il rappelle entre autres que si le Canada et le Royaume-Uni, depuis deux décennies, ont tous deux multiplié les excuses envers divers groupes à qui ils ont causé du tort au cours de leur histoire (y compris pour le massacre de chiens d’attelage inuits dans les années 1950-1960), les Acadiens restent ostensiblement absents du lot, eux qui, de 1755 à 1763, lors du « Grand Dérangement », ont été soit déportés soit fusillés, et spoliés de leurs terres et de leurs cheptels. On pourrait estimer à quelques millions les descendants de ces Acadiens éliminés, environ 12 000, qui peupleraient aujourd’hui l’est du Canada si on les avait laissés vivre sur les terres qu’ils occupaient paisiblement. Les autres populations francophones n’ont à ce jour pas eu droit à plus d’excuses quant aux mesures tyranniques adoptées par diverses provinces, aux premiers jours de la Confédération, pour interdire l’usage du français dans les écoles. Le Règlement 17, entre autres, qui est resté en vigueur durant quinze ans (de 1912 à 1927), « laissa des traces profondes dans la mémoire des Franco-Ontariens ». Ceux-ci n’auront d’ailleurs jamais fini de se battre, comme en font foi la décision de fermer le seul hôpital francophone de l’Ontario en 1997 (décision invalidée par les tribunaux quelques années plus tard après une rude bataille de la collectivité francophone) ou celle d’annuler l’ouverture d’une deuxième université francophone – même si le chantier était déjà bien avancé – par Doug Ford en 2018. Henrie tient toutefois à nous rappeler que la population franco-ontarienne (aujourd’hui 744 000 personnes) continue d’augmenter en nombre absolu, quoiqu’elle diminue en proportion.