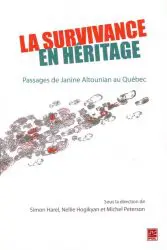Tout, dans cette réflexion sur le génocide et le traumatisme collectif qu’il inflige, s’articule depuis les textes et propos de Janine Altounian. Textes tirés de son parcours ou inspirés du journal de son père en fuite, propos échangés avec des Québécois férus de psychanalyse. Janine Altounian propose une subversion, un renversement du génocide : au lieu de le laisser « exclure radicalement, […] délier des individus et des groupes de l’ensemble de la communauté humaine », elle lui demande « la réintégration du sujet dans l’ordre des vivants en inscrivant les traces d’un univers perdu dans le texte culturel de l’humanité ». Les membres de ce collectif commenteront, osant parfois l’enrichir, ce processus proposé en réconfort, celui du « déplacement culturel ». Dans le cas de l’auteure, c’est par l’école de la République et par la langue française qu’il s’est effectué : « Il s’agit en somme de reprendre à son compte le déplacement catastrophique initial afin qu’il soit assumé, exploité et non subi ».
Le livre répercute la formation et les activités professionnelles de ses signataires : les références, l’argumentation, le lexique en sont marqués. Les lecteurs peu initiés (dont moi) auront du mal à apprécier les nuances ; ils éprouveront néanmoins (comme moi) un grand respect pour l’énorme investissement de doutes, de soucis, de recherches, d’explorations que ces spécialistes consentent pour assurer la pertinence de leurs analyses. Jacques Mauger met en garde : l’empathie peut être un malentendu et la bienveillance un excès. Nellie Hogikyan rappelle qu’elle et Janine Altounian ont un génocide en commun. Garine Papazian-Zohrabian évoque les risques encourus par les traducteurs et l’apport spécifique de la traduction du manuscrit de Vahram Altounian, père de Janine. Michel Peterson, nanti de compétences multiples, circonscrit prudemment « le noyau pur du langage » propre à Janine Altounian ; mieux que d’autres, il entrevoit la relation entre la langue de Freud, l’allemand, et ce qu’y puise la psychanalyse universelle. « […] dans ce passage des frontières d’un texte et d’une langue à l’autre, il n’y a pas que ce qui se trouve infirmé, périt, meurt, disparaît, tombe en ruine et en cendres une fois consommée la consommation ; un texte, une parole, une pensée survivent bien, demeurent en vie, croissent, multiplient la vie. »
Deux contributions me paraissent ressortir, en raison peut-être de leur recours à des champs moins spécialisés : celui de Marie Desrosiers, imprégné des présences de la chanson, et celui de Simon Harel, puissamment et lucidement nourri de littérature. Marie Desrosiers se penche sur la survivance des enfants adoptés : eux aussi survivent à l’abolition de la filiation. Simon Harel confesse le désarroi qui l’a ébranlé au cours de la rédaction de son texte : « […] j’ai été pris d’un malaise sans borne. Insomnie, cauchemars, marches somnambuliques au cœur des rues de ma ville natale. Que m’arrivait-il au juste ? » Face à l’infigurable, il entendait éviter « le caractère insupportable » du discours dont les lettres se satisfont souvent à propos du génocide. Heureusement le carquois de Harel est riche : le génocide lui rappelle (de loin) l’hallali qui, comme le génocide, associe plusieurs responsabilités ; la relation entre littérature et méchanceté fait partie de ses univers déjà patrouillés ; de l’écriture-hébergement, il connaît aussi bien les attraits que les limites… « Tout se passe en effet, comme si j’avais rêvé, dans un mouvement d’après-coup, d’une écriture qui offre toute la protection souhaitée à celui qui se croit menacé de mort. […] Cependant, quelle que soit la valeur indéniable des écrits de Janine Altounian, nous butons sur le caractère irreprésentable du génocide, la peur que la crainte de l’extermination suscite en nous. »
On grefferait volontiers à ces dérangeantes réflexions les vues d’autres auteurs. Pensons à Anne Michaels (La mémoire en fuite, Boréal, 1998) et aux divers ouvrages de Vincent Engel : dans les deux cas, la génération qui succède aux survivants d’un génocide affronte les défis que décrit Janine Altounian.