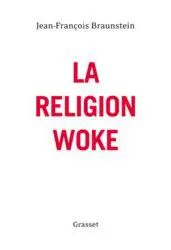Le mot woke est apparu la première fois aux États-Unis dans la communauté afro-américaine au cours des années 1960. Cet appel à l’éveil visait à contrer le racisme qui régnait partout et appelait ses victimes à la vigilance. Il est repris avec force en 2014 à la faveur du mouvement Black Lives Matter, créé dans le sillage de la mort de George Floyd. Depuis, ce mouvement, antiraciste à l’origine, s’est répandu à la vitesse grand V partout en Occident.
De mouvement de protestation qu’il était au début, le wokisme s’est vite transformé en idéologie englobant dans sa lutte, outre les enjeux liés au racisme, ceux qui se rapportent à l’identité de genre, à l’orientation sexuelle ou encore à la colonisation. Mais en même temps qu’il élargissait son champ d’intervention, le mouvement s’est radicalisé, jusqu’à l’absurde parfois, nous dit Jean-François Braunstein.
Ainsi, d’après la doxa woke, tous les Blancs sont intrinsèquement racistes et tous les Noirs sont des victimes. Mieux, « l’histoire occidentale [ayant] toujours été raciste […] cela invalide l’ensemble de ses productions culturelles, scientifiques, artistiques et techniques ». Paradoxalement, en déterminant la race comme premier marqueur identitaire, les partisans du mouvement Woke confirment la prééminence de ce qu’ils prétendent combattre, le racisme.
Dans ce courant de pensée, on n’en est toutefois pas à une aberration près, nous dit l’auteur. Il rappelle que, selon cette idéologie, ce n’est plus la biologie qui détermine l’appartenance à un sexe mais le ressenti des individus. Ainsi, si quelqu’un se réclame d’un autre sexe que celui qui lui a été attribué à sa naissance, on nous somme d’accepter le fait sans autre débat et d’adapter la société aux désidératas de cette personne, sous peine de lynchage dans les médias sociaux.
En effet, le discours issu du mouvement Woke condamne sans appel tous ceux qui ne partagent pas sa vision des choses. Pour contrer tous les arguments que l’on pourrait leur opposer, les thuriféraires du nouvel évangile affirment d’ailleurs, sans nuance, que « la vérité n’existe pas en tant que telle : elle est toujours ‘située’ à l’intérieur d’un certain état social […]. Pour [eux] nous n’existons que comme membres d’une communauté, qu’elle soit victimaire ou coupable ».
« Le caractère très intolérant de la religion woke et son refus de s’adresser à ceux qui ne partagent pas son point de vue, son absence de transcendance, font qu’elle ressemble […] à une secte à dimension politique et sociale […]. Il est impossible de convaincre un membre d’un tel groupe sectaire. » D’ailleurs, ajoute Braunstein, « [ses adeptes] n’acceptent même pas de débattre et répondent à toute critique par ‘l’annulation’ de leurs interlocuteurs ». C’est ce que les médias américains ont baptisé la cancel culture.
Pour expliquer son succès jusque dans les cénacles universitaires, l’auteur, lui-même professeur de philosophie contemporaine à la Sorbonne, avance comme hypothèse que « la religion woke » est le nouvel ancrage des valeurs spirituelles autrefois afférentes aux croyances religieuses traditionnelles. Le wokismeserait donc une réappropriation des vertus perdues avec le déclin des religions. Mais, en élevant ses a priori au rang de dogmes irréfutables, il est devenu un nouveau fondamentalisme qu’il faut combattre comme tel, nous enjoint Jean-François Braunstein. Et au vu de l’ardeur de ses défenseurs, cette bataille n’est pas gagnée d’avance.