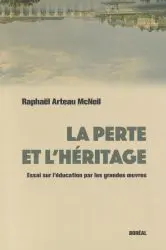À quoi sert l’éducation ? La réponse à cette question a évolué au fil des siècles, depuis l’Akadémiade Platon jusqu’à nos universités contemporaines commanditées par les institutions financières et les aciéries.
On le sait, au Québec à tout le moins, depuis la Révolution tranquille, les études dites « humanistes » ont « pris le bord », au profit d’une conception utilitariste de l’enseignement, mais aussi dans la foulée d’une certaine vision de la démocratie. Aux jeunes, on choisira dorénavant de faire lire non pas d’abord ce qui les fait grandir, mais ce qui est à leur portée. La méfiance envers tout ce qui pourrait représenter l’autorité, voire tout ce qui pourrait prétendre à une supériorité quelconque, méfiance héritée de Mai 68, a depuis gonflé jusqu’à refuser un ordre de préséance aux œuvres littéraires (entre autres) : sur quelle base prétendra-t-on que Madame Bovary doive passer avant Harry Potter ? Le jugement de l’éducateur ? Peuh ! Ne sait-il pas, celui-là, que son jugement en vaut bien un autre, et que l’apprentissage appartient à l’apprenant ?
Et pourtant, au milieu de cette évolution, un quarteron de résistants croient à la valeur éducative de ce qu’ils osent encore appeler les « grandes œuvres littéraires ». Ce sont eux qui, sous la houlette de Raphaël Arteau McNeil, ont créé à l’Université Laval, il y a dix ans, le certificat sur les œuvres marquantes de la culture occidentale, qui regroupe tant bien que mal chaque année quelques dizaines d’étudiants ouverts à l’idée que, peut-être, une œuvre qui a traversé les siècles a quelque chose à leur dire aujourd’hui. Que, peut-être, une œuvre peut demander des efforts de prime abord, mais réserver des trésors à qui sait se retrousser les manches et se laisser guider par d’autres qui sont passés par là.
Depuis l’origine, au-delà de son petit cercle d’adeptes, ce certificat suscite au mieux l’indifférence, au pire la raillerie. Ses animateurs n’en sont que trop conscients, et c’est dans le sillage des quolibets du monde, qui ont manifestement suscité chez l’auteur une réflexion profonde, honnête et permanente sur le bien-fondé de son entreprise, qu’est né ce petit bijou.
Ce qui frappe d’emblée à la lecture de cet essai – et l’impression ne se dément pas au fil des pages –, outre la densité et la qualité de l’écriture, c’est une attitude de plus en plus rare de nos jours, et qui met du baume à l’âme du lecteur : l’auteur n’est pas polémique. Son livre arrive indéniablement en réponse à des attaques répétées, mais il ne manifeste ni outrage, ni mépris, ni arrogance. « Mon discours tient de l’essai, non du pamphlet : mi-témoignage, mi-plaidoyer, il se peut qu’il n’ait pas la force de gagner la conviction de qui n’est pas déjà convaincu du mérite inestimable des grandes œuvres. » Ce discours même est éloquent : il offre une réflexion originale, inspirante, lucide et structurée, non seulement au sujet de l’histoire et de la pensée humaines, mais aussi au sujet du monde contemporain, en y mettant sa propre subjectivité, tout en s’appuyant – inévitablement – sur les grands auteurs.
Son livre présente d’ailleurs l’originalité de reprendre plus ou moins librement le plan du Discours de la méthode. Descartes est justement un bon point de départ : notre monde technologique n’est-il pas le triomphant héritier de sa foi en la rationalité ? Mais ce monde a oublié une faille dans le raisonnement de Descartes : « Le bon sens, dit-il, est la chose du monde la mieux partagée ». Est-ce si vrai ? Devant la surconsommation, la pollution, les inégalités, les drames humains et la cupidité ambiante, qui prétendra que l’individu, au-delà du culte qu’on lui voue, n’a pas besoin d’être éduqué par plus grand, par plus sage que lui ? « C’est l’intuition que j’ai cherché à étoffer tout au long de cet essai : nos faiblesses innombrables et nos vices médiocres poussent en nos personnes comme la mauvaise herbe sur une terre mal cultivée. […] L’éducation sérieuse, celle qui s’appuie sur les grands textes dont nous avons hérité, cultive le jugement, le goût et la décence. »
Certains le savent, d’autres non : le mot « école » est issu d’un mot grec qui signifie « loisir ». Derrière ce paradoxe apparent se cache une réalité oubliée : à l’époque de Socrate, comme à peu près à toutes les époques et dans toutes les sociétés sauf les nôtres, les gens n’ont pas le temps d’étudier ; il faut travailler pour survivre. « À l’échelle de l’humanité, nous sommes des privilégiés qui pourraient jouir du luxe de s’éduquer. Mais nous ne le faisons pas, ou si peu. » L’auteur ne nous en fait pas la morale. Mais il réclame le droit de dire que l’humanité se porterait peut-être mieux si on utilisait à meilleur escient cette abondance de temps et de moyens que la société technologique nous offre sur un plateau d’argent.
LA PERTE ET L’HÉRITAGE
ESSAI SUR L’ÉDUCATION PAR LES GRANDES ŒUVRES
- Boréal,
- 2018,
- Montréal
173 pages
18,95 $
Loading...
Loading...
ESPACE PUBLICITAIRE
DERNIERS NUMÉROS
DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE
Loading...