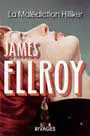« Je détestais ma mère parce que je la désirais de diverses façons, toutes inqualifiables. » C’est l’aveu que fait James Ellroy au début de La malédiction Hilliker où il revient, après Ma part d’ombre paru en 1995, sur l’assassinat de sa mère, Jean Hilliker, alors qu’il n’avait que dix ans. Si Ma part d’ombre se lisait comme un rapport d’enquête sur un meurtre, La malédiction Hilliker se lit comme la confession d’un « serial lover » un rien incestueux.
Toute sa vie, Ellroy a été obsédé par les femmes, surtout par celles qui avaient l’allure et la dégaine de sa mère. Éros et Thanatos se trouvent ainsi très tôt liés à son désir amoureux. Il le sait, sa libido porte en elle quelque chose de destructeur d’où la malédiction dont parle le titre. Il en donne pour preuves ses virées d’adolescent pour épier la nudité des jeunes filles de bonnes familles, ses introductions par effractions pour violer leur intimité, sa consommation effrénée de drogue et d’alcool – jusqu’au coma éthylique à 29 ans – ou ses séances de masturbation compulsive.
Au cours des années, il connaîtra des périodes d’accalmie amoureuse, voire de bonheur domestique. Mais, chaque fois le fantôme de Jean Hilliker viendra exiger son dû. Il faut savoir qu’Ellroy s’est toujours senti responsable de la mort de sa mère parce qu’il l’avait souhaitée peu de temps avant qu’elle ne soit assassinée. Cette culpabilité réveille alors ses vieux démons ‘ goût morbide de l’obscurité, voyeurisme, obsessions hallucinatoires – et finit par lui aliéner l’amante du moment. Le même scénario se répète à chaque histoire d’amour.
Si le propos du livre est un peu répétitif, on ne peut reprocher à la plume de l’écrivain de manquer de souplesse tant elle joue sur les variations stylistiques et les ruptures de ton; Ellroy passant dans le même chapitre de l’admonestation à l’envolée poétique, de la description froide à l’allégorie, du trivial au grandiloquent. Au point où le lecteur en est parfois dérouté.
À lire La malédiction Hilliker, les amateurs n’apprendront rien d’essentiel sur Ellroy, si ce n’est quelques détails triviaux (dont sa fixation sur la contralto Anne Sofie von Otter). Ceux qui ne le connaissent pas devraient plutôt aborder son œuvre par ses grands livres ‘ American Tabloïd, Le Dahlia noir ou Ma part d’ombre, par exemple ‘ plutôt que par cet exercice narcissique, par ailleurs éclairant en ce qui concerne la psyché de l’auteur.