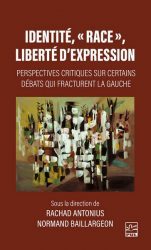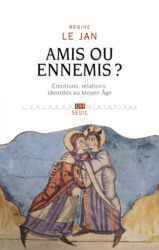En ce moment, on assiste à un retour du balancier face aux « nouvelles sensibilités », ou encore, pour faire court, au wokisme. L’ouvrage dirigé par Rachad Antonius et Normand Baillargeon s’inscrit dans ce courant.
Une vingtaine de collaboratrices et collaborateurs ont été invités à se prononcer sur ces enjeux actuels liés à l’identité, à la race et à la liberté d’expression. Il ne faut pas se surprendre si plusieurs reviennent sur l’histoire de Verushka Lieutenant-Duval, un cas d’école. Rappelons que cette chargée de cours de l’Université d’Ottawa avait prononcé le mot « nègre » à la fin d’un exposé afin de souligner, à l’instar du mot « queer », sa resignification subversive par certains groupes sociaux. Or, une étudiante s’est sentie mal à l’aise à l’écoute de ce mot et s’en est plainte. On connaît la suite : la chargée de cours a été harcelée par des étudiants. Elle a même été suspendue par l’université, qui ne l’a pas défendue.
L’ouvrage se divise en quatre grandes parties. La première porte sur les origines de cette nouvelle gauche qui prend racine dans les universités américaines. On la remarque en ceci qu’elle s’inscrit en faux contre les idéaux des Lumières, dont l’universalisme qui masquerait une domination blanche. Selon quelques auteures et auteurs, cette gauche se rapprocherait du discours religieux en divisant le monde entre « bons » et « méchants ». Elle cherche à punir ces derniers en les annulant. Elle remplace l’analyse et l’objectivité par la morale et la vertu. S’appuyant sur les distinctions faites par le sociologue Max Weber il y a plus d’un siècle, Marc Chevrier rappelle dans sa contribution que le militantisme n’a pourtant pas sa place dans les universités, terreau fertile du wokisme.
Une deuxième partie concerne les transformations du politique. Il n’est plus question de peuple ou de citoyens, mais de victimes. Les sensibilités et les offenses occupent un large espace social et médiatique. Ayant perdu de vue la critique du néolibéralisme et de l’exploitation des classes sociales, la nouvelle gauche perd du même coup contact avec les milieux populaires, les livrant ainsi à la droite populiste qui ne demande pas mieux.
Une troisième partie concerne des études de cas précis : le postmodernisme en éducation, l’appauvrissement des débats (seuls les bons représentants sont tolérés), l’appropriation culturelle. Sur ce sujet, Maka Kotto, Africain d’origine, témoigne du fait qu’il s’est approprié des auteurs caucasiens sans que cela pose problème. Des auteurs comme Franklin Midy et Claude Dauphin déplorent l’agitation de certains autour de l’usage du mot « nègre ». Le faire disparaître ne réglerait en rien le racisme réel. D’ailleurs, dans le contexte de la littérature haïtienne et francophone d’Afrique, se passer de cette expression équivaudrait à occulter tout un pan de recherche.
La dernière partie est la plus brève. Rhéa Jean et Michèle Sirois abordent l’épineuse question du sexe, du genre. Elles explorent, entre autres, la possibilité que les droits des femmes s’amoindrissent à force de discours sur la transidentité.
Une critique de cet ouvrage pourrait se faire entendre : tous les intervenants dénoncent les errements de la gauche postmoderne. Quelques concessions pointent ici et là, sans plus. Les deux directeurs de cette publication ne s’en cachent d’ailleurs pas : ils ont recherché des textes critiquant le développement de cette mouvance qui laisse de côté, à leurs yeux, des luttes plus urgentes comme les inégalités socio-économiques.
Qui sait, peut-être ce livre a-t-il influencé le rapport de la commission Cloutier sur la liberté académique paru en décembre dernier ?
Saluons l’effort de la nuance. Après tout, tout n’est pas noir ou blanc.