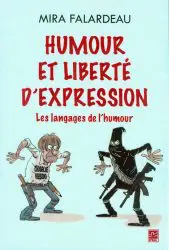Spécialiste de la bande dessinée, de la caricature et du cinéma d’animation, Mira Falardeau s’intéresse depuis longtemps au phénomène de l’humour. L’humour visuel avant tout, mais également l’ensemble des langages et des techniques humoristiques. Ainsi dans son ouvrage précédent, Femmes et humour (PUL, 2014), elle proposait cinquante portraits de femmes « cartoonistes » d’Amérique du Nord, d’Europe, du Maghreb et du Moyen-Orient. Dans Humour et liberté d’expression, elle nous convie à une promenade « dans des territoires où le rire a toujours été en opposition avec le pouvoir en place ».
Le thème du premier chapitre (« Sacré humour ») allait de soi, puisque les attentats du 7 janvier 2015 contre Charlie Hebdo étaient encore tout récents quand l’auteure rédigeait son essai. Falardeau saisit ainsi l’occasion de montrer que l’association entre la religion, le rire et la grivoiserie n’est pas apparue au xxie siècle, car on la retrouve déjà dans la Grèce antique lors de certaines fêtes ritualisées, puis dans les fabliaux et les farces du Moyen Âge. Continuant son travail d’historienne au deuxième chapitre (« La naissance du langage humoristique »), Falardeau retrace les débuts de la parole comique à partir de sources variées, des comédies d’Aristophane et des graffiti pompéiens jusqu’aux écrits de Rabelais, aux comédies de Shakespeare et aux croquis ou dessins des Carrache et Le Bernin. Très bref (à peine trois pages), le chapitre suivant énumère quelques « procédés de l’humour » qui seront abordés plus longuement dans les dix chapitres restants du volume : l’exagération, la simplification, le contraste, les jeux de mots et d’images, parmi d’autres.
Avec ses nombreux encadrés, mots ou passages marqués en caractères gras, ainsi que son lexique et sa bibliographie en fin de volume, Humour et liberté d’expression a manifestement été conçu pour être simple à consulter. Cette approche a pour inconvénient de verser parfois dans une concision et des raccourcis qui surprennent pour un ouvrage publié chez un éditeur universitaire. Par exemple, les enjeux reliés aux médias sociaux et leur sphère « semi-publique » auraient pu donner lieu, plutôt qu’à une conclusion de quatre pages et demie, à un développement plus étendu. Le lecteur curieux restera sur sa faim.
ESPACE PUBLICITAIRE
DERNIERS NUMÉROS
DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE
Loading...