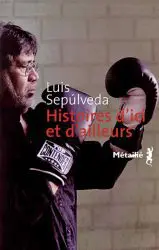Deux veines structurent l’écriture de Luis Sepúlveda. Il y a d’abord les œuvres fictives, centrées sur le développement d’une trame sociale et politique autour de personnages attachants et humbles. Le romancier y transpose, qu’il soit beau ou hostile, le réel, vu d’une lorgnette latino‑américaine, en leçons de vie aux fins d’une morale combattante. Dans ce courant, Le vieux qui lisait des romans d’amour et Un nom de torero sont ses réussites, où affleurent écologisme, solitude, défaites et espoir. Il y a aussi la veine qui joint son penchant testimonial à sa profession de journaliste. Il en résulte de courts portraits impressionnistes, qu’ils soient autobiographiques ou non, dans lesquels l’écrivain construit un univers de fraternité et d’honneur. Le recueil d’escarmouches et d’historiettes, pour reprendre des termes de Jacques Ferron, autre écrivain ayant une politique d’écriture (Ferron a de plus l’humour), Histoires d’ici et d’ailleurs appartient à la seconde catégorie, avec Les roses d’Atacama et La folie de Pinochet.
Sepúlveda excelle à camper un personnage, à saluer les vertus d’un ami, à redécouvrir une injustice cachée, et le recueil abonde de ces plaidoyers pour la résistance, pour la droiture devant le capital et sa cohorte de profiteurs rampants. Des écrivains sont ainsi célébrés (Mario Benedetti, Miguel Rojo, Nelson Saúte), tout comme des artistes (dont le photographe Daniel Mordzinski, qui fournit l’œuvre sur la couverture du bouquin) et des quidams anonymes exhaussés au rang de modèles et d’inspirations. Si le sentimentalisme affleure à chacune des pages, si les confessions et témoignages de l’auteur sont souvent déjà connus et présentés sous un jour toujours favorable, si l’effet « viande froide » inspirée perce l’œuvre à l’occasion tant sont nombreux les textes qui soulignent la mort de proches, il existe quand même un charme à l’écriture de Sepúlveda, qui tient à la sincérité du propos, à la tonalité particulière de la douce colère qui transperce les chroniques et à la manière de rameuter les traces de beauté dans un monde marqué de multiples ruines.
Ainsi, c’est dans l’évocation de l’exil, puis du retour au pays natal, que le recueil prend sa forme, notamment par le texte liminaire, le plus approfondi et qui fonctionne comme un cadre éthique et esthétique pour expliciter son art du portrait. Dans ce texte, l’écrivain décrit son émotion devant la photo d’enfants purs et innocents pris dans le maelström de la dictature. Il décide, huit ans après la prise de la photographie, de retrouver ces inconnus et de leur donner la parole, afin de cerner comment le rêve transverse les époques et se heurte aux assauts du temps et des humains. Ce beau texte, émouvant, contient en germe la manière Sepúlveda, avec ses raccourcis, ses emballements lyriques, sa morale appuyée, mais surtout avec cette candeur qui surprend encore après une quinzaine de livres.