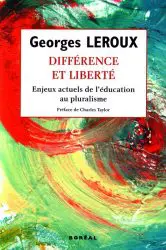Figure marquante de la philosophie au Québec – avec Charles Taylor, qui signe d’ailleurs la préface du livre – Georges Leroux est l’un des principaux penseurs du programme Éthique et culture religieuse, enseigné dans les écoles du Québec depuis 2008. Si le programme a finalement recueilli une large adhésion, ce ne fut pas sans provoquer quelques remous. On se souviendra qu’une demande d’exemption d’un couple catholique de Drummondville donna lieu à une procédure judiciaire à l’issue de laquelle la Cour suprême du Canada devait réfuter les arguments des demandeurs. Le projet s’est attiré son lot de critiques, alimentées tout autant par la perspective laïciste que par la vision religieuse. À la faveur des travaux pour concevoir et diffuser le programme, à travers les débats suscités notamment par le caractère obligatoire de la formation, Georges Leroux a développé et raffiné sa position sur la question du pluralisme. Il s’en explique dans son dernier essai.
Le philosophe s’appuie avant toute chose sur le fait incontestable de la pluralité des systèmes de valeurs et des croyances dans les sociétés contemporaines, parmi lesquelles le Québec ne fait pas exception. Cette réalité, désormais nôtre, pourrait selon certains fragiliser la qualité du vivre-ensemble et de la démocratie. Georges Leroux n’ignore pas ce risque et propose de tirer parti de la pluralité par l’ouverture, plutôt que de chercher à s’en protéger. Cela signifie entre autres pour lui que les citoyens devraient être en mesure de développer dès leur plus jeune âge, à travers leur parcours scolaire, leur aptitude au dialogue et à la compréhension interculturelle. Voilà l’objectif du programme Éthique et culture religieuse : non pas l’acquisition d’une connaissance encyclopédique des valeurs et des religions, mais plutôt l’accès à la compétence d’assumer ses propres choix dans un monde pluraliste : « […] la question de l’équilibre pour chacun de la raison et de la croyance, apparaît comme le thème cognitif de ce programme : à travers la diversité des conceptions du monde et des représentations auxquelles il aura accès, chaque jeune sera invité à poser cette question pour lui-même ».
L’approche d’ouverture préconisée par Leroux est contestée d’un point de vue religieux, selon lequel les parents croyants ne devraient pas être obligés d’exposer leurs enfants à d’autres croyances et à d’autres valeurs, au risque de fragiliser leur foi. À l’opposé, certains promoteurs de la laïcité assimilent le programme Éthique et culture religieuse à un « endoctrinement religieux » constituant une entrave au mouvement de laïcisation de la société et, de ce fait, contestent sa pertinence dans le cadre du système public d’éducation. Enfin, les tenants d’un certain nationalisme craignent que le programme contribue à diluer les bases de la culture québécoise commune. Face à ces critiques, le philosophe fait le pari de l’équilibre et plaide pour le dépassement d’une approche individualiste des enjeux du pluralisme. Les croyants ne pourraient-ils pas enrichir leur foi au contact de celle des autres ? Les laïcs ne devraient-ils pas reconnaître l’apport original de la religion à la culture ? Et comment concevoir l’épanouissement d’une culture commune québécoise autrement que dans le dialogue et la compréhension mutuelle ? En définitive, le philosophe croit que les opposants, quel que soit leur camp, sont motivés par la peur de l’inconnu, ce qui ne constitue pas une base d’argumentation solide.
En plus de l’éclairage apporté par le philosophe sur sa position et ses fondements, l’ouvrage vaut pour les nombreux rappels historiques sur l’évolution du système d’éducation ici et ailleurs en Occident. Enfin, le philosophe marque nettement sa distance par rapport à un relativisme radical qui ne reconnaîtrait aucun universalisable : « Nous devons soutenir un perfectionnisme substantiel, susceptible de proposer des valeurs et des vertus à condition qu’il ne soit pas autoritaire et qu’il soit présenté dans une perspective d’édification infinie, fondée sur la discussion constante des valeurs et sur les moyens choisis pour parvenir à des fins ».
À la lecture de ce livre, on pourra penser que Georges Leroux vit dans un monde idéalisé. On pourra se demander notamment si une telle déférence à l’endroit de l’institution religieuse est réellement nécessaire. Toutefois, on ne pourra qu’admirer la noblesse de la démarche de l’auteur, la qualité de sa réflexion et son souci de transparence. Pour ne rien gâcher, le tout est livré dans une forme accessible et avec générosité.
ESPACE PUBLICITAIRE
DERNIERS NUMÉROS
DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE
Loading...