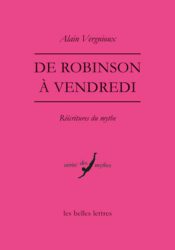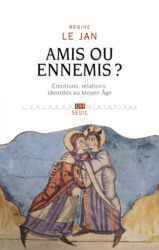Le roman de Daniel Defoe, Vie et aventures de Robinson Crusoé (1719), a donné lieu à d’innombrables réécritures et adaptations. Aussi le considère-t-on à l’origine d’un mythe littéraire qui semble intarissable.
Après Jean-Paul Engélibert en 1997 (La postérité de Robinson Crusoé. Un mythe littéraire de la modernité 1954-1986), Alain Vergnioux entend donner une idée de la fascinante adaptabilité des robinsonnades. À cette fin, il a retenu une dizaine d’œuvres qui sont à ses yeux parmi les plus significatives. D’abord au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle, l’Émile (1762) de Jean-Jacques Rousseau de même que les romans Le nouveau Robinson (1781) de Joachim Heinrich Campe et Le Robinson suisse de Johann David Wyss (1812) « opèrent la mutation pédagogique moderne du récit ». L’adversité à laquelle font face les protagonistes doit servir à promouvoir une « éducation naturelle » et l’acquisition de « compétences morales, spirituelles et cognitives ». Puis, Jules Verne fait entrer le récit dans l’ère industrielle avec divers romans, notamment L’île mystérieuse (1874), dans lesquels les héros doivent faire preuve d’ingéniosité, de rationalité scientifique et technique pour assurer leur survie. À partir du XXe siècle s’amorce une forme de subversion des valeurs initiales du récit de référence. Suzanne et le Pacifique (1921) de Jean Giraudoux, qui a la particularité de mettre en scène une femme naufragée, laisse entrevoir une critique de la civilisation industrielle et technique que Verne associait au progrès matériel et social. La remise en question s’accentue avec l’anti-robinsonnade Vendredi ou les limbes du Pacifique (1967) de Michel Tournier. « Là où les héros verniens sortaient renforcés dans leur identité, faite de courage, d’initiative et d’intelligence, le Robinson imaginé par Tournier voit son existence se diluer en même temps que s’annihilent ses certitudes. » On le sait, le Robinson de Defoe inculque à Vendredi le modèle ethnocentriste et colonialiste de la civilisation occidentale. Celui de Tournier est plutôt converti par Vendredi à un mode de vie axé sur l’émancipation et en harmonie avec la nature. Peut-on alors parler d’une relecture hypertextuelle contre-ethnocentriste et postcolonialiste ? À cet égard, Vergnioux ne rappelle pas la fameuse remarque de Gérard Genette concernant le roman de Tournier : « Quelqu’un, ici, dit ‘Vendredi avait raison’, mais ce quelqu’un, malgré une dévocalisation de surface, c’est toujours Robinson. Le véritable Vendredi, où Robinson serait vu, décrit et jugé par Vendredi, reste à écrire. Mais ce Vendredi-là, aucun Robinson – fut-il le mieux disposé – ne peut l’écrire » (Genette, Palimpsestes, 1982). Dans son roman Foe (1986), J. M. Coetzee semble faire écho à cette critique en mettant en scène un Vendredi « insondablement silencieux ». Selon Vergnioux, « ce que le roman [Foe] dénonce, à travers le personnage de Vendredi, c’est le silence qui pèse sur l’esclavage », sur « l’histoire de la colonisation et des crimes qui l’ont accompagnée. […] la ‘vérité’ de Vendredi […] ne pourra être dite que dans une ‘Autre’ histoire ».
On le voit, les réécritures réaménagent chacune à leur façon le mythe dont le propre est de suggérer de possibles modes de résolution des épreuves ou des crises d’ordre idéologique. Au demeurant, les variantes remobilisent l’histoire d’une situation en apparence désespérée, voire « d’une crise existentielle profonde », qui implique pour le héros de trouver (dans la nature, dans les valeurs morales, dans le travail, dans la technologie, dans le rapport à l’autre, en soi, etc.) les ressources pour la surmonter. Et cette quête salutaire appelle, pour reprendre le propos de Vergnioux au sujet du roman de Giraudoux, la « transformation de soi et du regard sur le monde, une méditation sur le sens de l’existence humaine ».
En somme, le mythe est hautement recyclable, il ne demande qu’à être actualisé. Par exemple, qui réécrira l’aventure de Robinson à l’aune des problèmes actuels de solitude ou de santé mentale ? Je pense ici aux propos de l’écrivaine Régine Detambel, connue entre autres pour ses ouvrages de bibliothérapie créative (Les livres prennent soin de nous, 2015 ; Lire pour relier, 2023), qui considère justement l’œuvre de Defoe comme un roman thérapeutique, un roman de sortie de dépression ou de désespoir grâce à des activités comme la marche, l’agriculture, l’élevage de chevreaux, la lecture, la rencontre de l’Autre, etc. En effet, après deux ans sur son île, le personnage ne fait-il pas le constat qu’il est parvenu à se défaire de « ses réflexions chagrines à la vue de [sa] condition », tout obsédé qu’il était par « les barrières éternelles de l’Océan » (Defoe, 1949 [1719]) ? Ses pensées dépressives obsédantes qui, « comme un orage, [l]e jetaient dans le trouble et le désordre » ne finissent-elles pas, sous l’action bienfaisante de l’écriture et de la lecture, par laisser alors place à une certaine sérénité : « Mais à cette heure mon esprit se repaissait d’autre chose ; la lecture de la parole de Dieu faisait partie de mes occupations journalières ; et de cette source émanaient toutes les consolations dont mon état présent avait besoin » (Defoe, 1949 [1719]) ? Manifestement, le mythe a encore un bel avenir devant lui.