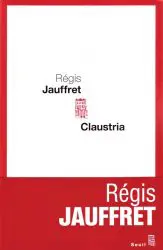Stendhal, Gide, Simenon, Genet, Giono, Mallet-Joris, Besson… La liste est longue des écrivains dont certaines œuvres – parfois de grands textes, comme De sang-froid de Truman Capote ou L’adversaire d’Emmanuel Carrère – sont la transposition de faits divers. Loin de faiblir, ce phénomène semble s’être intensifié depuis quelque temps, avec des livres comme Les cœurs autonomes de David Foenkinos, Le cimetière des poupées de Mazarine Pingeot ou Belle famille d’Arthur Dreyfus. Avant de se pencher sur l’affaire Fritzl, Régis Jauffret avait donné sa vision de l’affaire Stern dans Sévère (2010), roman que la famille du banquier assassiné avait tenté, sans succès, de faire interdire.
L’affaire Fritzl donc… Elle a éclaté en 2008 et révulsé le monde entier. Josef Fritzl, un ingénieur autrichien, a séquestré sa fille Elisabeth dans une cave pendant 24 ans, l’a violée et battue à répétition et lui a fait sept enfants. Voilà, en gros, l’histoire sordide que relate Claustria. Pour ce faire, Jauffret a pris le temps de se documenter et de se rendre à Amstetten pour y rencontrer divers intervenants (avocat, psychiatre, policier, etc.) mêlés à l’affaire. Il en résulte un roman touffu et suffocant, produisant 500 pages d’inconfort, à l’image de la claustration qu’il raconte paradoxalement avec beaucoup de retenue. Se gardant bien de faire intervenir le moindre jugement moral, Jauffret a entrepris de « raconter » l’affaire Fritzl, non de l’expliquer. Devant l’horreur du sujet, il a compris qu’il était le plus souvent inutile d’entrer dans les détails.
Claustria se donne aussi à lire pour ce qu’il est : une œuvre de fiction. Jauffret a dû inventer certains détails, tel tout ce qui touche le domaine psychologique. Il s’en dégage un dérangeant portrait de monstre (que le romancier assimile judicieusement à un « ogre »), en même temps que celui, à fendre l’âme, de ses victimes, à commencer par la fille de Fritzl, renommée « Angelika ». Au départ, c’est la réminiscence du mythe platonicien de la caverne qui fascinait Jauffret dans ce fait divers : pour les occupants de la cave-prison, les seules images de l’extérieur leur parvenaient à travers un écran de télévision. Au final, c’est un récit aux multiples facettes que propose Jauffret. L’affaire Fritzl lui a permis par exemple de brosser un tableau glauque de l’Autriche (Claustria vient de « claustration » mais aussi d’« Austria »). Bernhard et Jelinek nous ont peut-être habitués à ce genre d’écrits. Venant d’un non-Autrichien, c’est beaucoup plus rare.