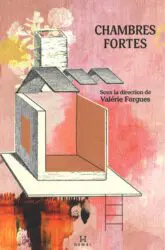Dans son célèbre et incandescent pamphlet, A Room for One’s Own, Virginia Woolf défend l’idée qu’il n’y a pas d’accès à la fiction sans indépendance économique et sans une chambre à soi.
S’inspirant de cette conclusion visionnaire, onze écrivaines québécoises et françaises explorent les lieux de l’élaboration de leur écriture et nous entraînent, là, dans une pièce où règnent « la solitude, l’anarchie de mes pensées et la douleur de mon sang » (Annie Lafleur), ici, dans une suite ornée de toiles d’araignée champenoises rivetée à la mémoire (Valérie Forgues), ou encore dans le cabanon, « ce lieu qui [me] laisse en paix », à distance de la maison champêtre trop bruyante et trop habitée (Sarah Desrosiers). Ce peut être aussi la confiance, cet espace intime, ce lieu en soi, cette chambre de répit (Andrée Levesque Sioui). « J’aurais une chambre à moi que je ne saurais rien y écrire si la confiance, l’urgence de dire, la santé me faisaient défaut. » Il arrive aussi que l’une tourne le dos aux murs protecteurs et leur préfère « une île nue traversée par les vents, offerte à la mer » (Fanie Demeule). Que le lieu soit réel ou symbolique, chacune s’acharne à y assouplir le muscle du verbe, descendant jusqu’aux vidures du langage s’il le faut.
Que sait-on de nouveau depuis la diatribe de Woolf parue en 1929 ? Le décor de nos écrivaines ne ressemble en rien à l’époque victorienne de Virginia, cependant que le désir tramé serré dans la peur d’écrire n’a guère changé. Non plus que la condition intrinsèque de l’acte lui-même, qui n’a pas bougé d’un iota, la solitude. Bénédiction, affliction ou punition, chacune s’y meut en explorant les rituels pour exorciser la peur et apprivoiser la solitude justement, freiner les distractions, composer avec la pudeur et le déficit de confiance. Chacune à sa façon, dans son lieu propre, se laisse dévorer par le désir éperdu de porter hors soi son expérience et ses connaissances de la vie.
La poésie se dépose partout sur les textes, y laisse des effluves tremblants de passion et d’espoir. Virginie Chaloux-Gendron exprime l’impérieux désir du luxe de la fiction et les difficultés d’y parvenir. Elle déplore que, avant même d’avoir terminé son livre, on lui demande de se transformer en produit de consommation. En définitive, rien n’est joué « malgré une chambre à moi / je cherche / où je me rends / quand je me perds / derrière l’évier de la cuisine / à 6 h 30 du matin ». Ces mots illustrent combien les réalités des femmes se sont modifiées. Sceptique à l’égard de l’argent tout en reconnaissant son absolue nécessité, elle écrit : « Le temps file et avec lui l’argent censé nous sauver alors qu’il nous condamne ». Courroucée, Virginia Woolf avait jadis lancé : « [N]otre mépris pour la répréhensible pauvreté de notre sexe éclata ». À ses yeux, la rente reçue de sa tante a été plus déterminante dans l’élaboration de son œuvre que l’obtention du droit de vote pour les femmes.
Dans une lettre très sensible qu’elle adresse à Virginia Woolf, l’Afropéenne d’origine sénégalaise Madioula Kébé-Kamara lui confie la douleur de l’invisibilisation de sa condition de femme noire en désarroi majeur et en espoir mineur. De ces deux modes ont surgi une énergie brute et le devoir de « tenter de devenir maîtresse du discours pour ne plus être le propos sur lequel se base l’Histoire ».
À entendre ces voix entremêlées, plutôt qu’une chambre à soi, aujourd’hui l’enjeu serait un temps à soi. À plus d’un demi-siècle d’intervalle, les traductions du titre A Room of One’s Own – d’abord Une chambre à soi (Clara Malraux, 1951), puis Un lieu à soi (Marie Darrieussecq, 2016) – illustrent ce saut sociologique. Autour de la dure question du temps gravitent celles de l’enfant et des aménagements constants pour préserver et se réserver temps et espace. « Il m’arrive de dresser la liste de nos écrivaines célèbres et de me vautrer dans le constat suivant : aucune n’a eu d’enfant. »
Valérie Forgues, chef d’orchestre de ces compositions littéraires, cite Jacques Poulin qui offre une clé riche de promesses. À la fin d’un temps d’écriture, il faut laisser la phrase en suspens, suggère-t-il. Tout sera ouvert, tout sera possible le lendemain. En définitive, quel qu’il soit, ce lieu de tous les devenirs de l’acte littéraire demeure, dans l’esprit de Forgues, un écrin pour la pensée.
Comme il le fait toujours, le temps a passé. Les réflexions d’Une chambre à soi ressuscitées en Chambres fortes, c’est-à-dire à l’abri de l’effraction ou de l’intrusion, n’ont rien perdu de leur justesse ni de leur pertinence.