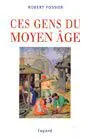C’est à la visite guidée d’un espace mental que nous convie Robert Fossier dans son dernier ouvrage, Ces gens du Moyen Âge. En effet, ni l’histoire des grands ni le rappel des hauts faits qui ont marqué ce long millénaire ne trouvent écho dans cet ouvrage. On n’y trouvera pas non plus un traité sur la vie quotidienne au temps des cathédrales, pas plus qu’un inventaire de types humains de l’époque : seigneur, chevalier, clerc, troubadour, etc. L’auteur laisse toute la place à l’homme du commun « dans son corps, son âme, son cerveau et son environnement ». Ce lointain ancêtre, Robert Fossier le saisit ici dans sa pérennité et nous le présente comme notre semblable.
L’historiographie traditionnelle fait remonter au Ve siècle le début du Moyen Âge pour le faire se terminer au XVIe siècle, avec la Renaissance. Or, rien ne relie le manant des temps carolingiens au contemporain de Jeanne d’Arc. C’est donc pour garder une certaine homogénéité à son propos que Fossier a restreint son champ à la période qui va du XIIe au XIVe siècle, français surtout. L’auteur y aborde tour à tour les questions du vieillissement, des rapports de l’humain avec la nature et avec les animaux, de ses modes d’apprentissages, de sa représentation de Dieu, de sa conception du bien et du mal, etc.
Le livre se déroule sur le ton de la causerie savante, dépouillée de l’appareillage coutumier du livre d’universitaire. Ce qui permet à l’auteur de formuler, au passage, ses propres opinions sur notre époque en la mettant en parallèle avec l’univers féodal. Mais, attention, si l’on échappe aux notes de bas de page, on n’échappe pas au vocabulaire pointu et à un style souvent précieux. Livre d’humaniste autant que d’érudit, d’une très grande richesse et facile d’accès, Ces gens du Moyen Âge dégonfle bien des mythes et des idées reçues sur l’homo medievus et son époque.