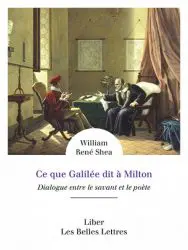Pendant que Galilée était assigné à résidence pour n’avoir pas dénoncé avec vigueur le copernicianisme comme le lui demandait l’Église, il reçut la visite du jeune poète John Milton, en tournée européenne. Que se sont-ils dit ? Aucun écrit ne le rapporte, alors William René Shea l’imagine pour nous.
La couverture annonce un peu trompeusement « Dialogue entre le savant et le poète ». On pourrait s’imaginer un grand dialogue philosophique entre la science et la poésie, entre le rationnel et l’irrationnel, entre les faits et l’imagination. En fait, l’auteur est un spécialiste de Galilée et non de Milton, et cette mise en scène n’est qu’un prétexte (au sens positif du terme) pour mieux nous faire connaître ce Florentin qui, au début du xviie siècle, a tellement fait progresser la science. Au fond, c’est plus ou moins une interview, qui aurait presque tout aussi bien pu s’intituler « L’Express rencontre Galilée ».
L’ouvrage débute d’ailleurs par des présentations des protagonistes dont la longueur et la teneur respectives ne trompent pas : une biographie de 25 pages pour Galilée et, pour Milton, une introduction d’à peine cinq pages expliquant le contexte de son voyage et de cette rencontre avec celui qui était de 44 ans son aîné.
La biographie et le dialogue constitueront pour le lecteur des fenêtres privilégiées sur le parcours de vie du savant, mais aussi sur sa façon de penser et celle de son époque. L’auteur a le mérite, grâce à sa connaissance approfondie du sujet, de dépoussiérer les images d’Épinal qui nous sont invariablement servies sur cette histoire. On sort ainsi d’une vision téléologique pour se plonger véritablement au cœur d’une époque. Rappelons que Galilée est né en 1564, et on a beau en faire un héraut de la science, il a vécu en un temps où celle-ci n’était ni perçue ni pratiquée comme aujourd’hui, un temps où « les mathématiques et la physique [étaient] des sujets mineurs que l’on ne peut enseigner que l’après-midi dans les universités », la prestigieuse matinée étant réservée à la théologie.
Soulignons d’ailleurs que Galilée pratiquait l’astrologie le plus sérieusement du monde, ayant à de nombreuses reprises tracé sa carte du ciel et celles de ses enfants pour éclairer les grandes décisions de sa vie, et consciencieusement fait l’horoscope d’une prestigieuse clientèle. Le télescope qu’il a inventé lui a permis de découvrir les quatre premiers satellites de Jupiter et de confirmer avec quasi-certitude la théorie de l’héliocentrisme qui avait été professée par Copernic trois quarts de siècle plus tôt, mais l’astronomie n’en était encore qu’à ses balbutiements. Galilée, par exemple, a assimilé des comètes à une simple illusion d’optique et croyait dur comme fer que les marées étaient causées par la force centrifuge du mouvement de la Terre, se moquant ouvertement des savants qui affirmaient que les comètes étaient des corps célestes dans le premier cas ou qui pointaient du doigt la Lune dans le second.
Tout le monde connaît l’histoire de Galilée convoqué par l’Inquisition pour réfuter la théorie de l’héliocentrisme. Shea nous la raconte à son tour, mais sans se laisser emporter par les caricatures de notre époque. « La condamnation de Galilée est souvent présentée comme le résultat d’un conflit inévitable entre la science et la foi. Cette interprétation a l’avantage d’être claire mais la réalité est plus complexe, plus riche et plus intéressante. » Pour Galilée, il n’y eut ni assemblée humiliante, ni cachot et encore moins de torture. Il fut certes assigné à domicile ; cela dit, les autorités ecclésiastiques n’avaient pas tort, à l’époque, de rappeler que la théorie de Copernic n’avait toujours pas été scientifiquement démontrée. Sans créer de polémique, Shea se contente ici de redresser les faits avec clarté, fort de son érudition, de son esprit de synthèse et de son admiration de l’auteur du Dialogue sur les deux grands systèmes du monde.
Bref, une plaquette fort instructive pour quiconque souhaite connaître à fond ce grand homme et son époque.