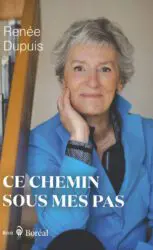L’auteure a décidé de raconter à ses trois petites-filles son parcours de vie « à partir de phrases, dit-elle, qui m’ont été adressées au cours des ans et qui me sont restées en mémoire ». Le titre des soixante-trois chapitulets du récit qui s’ensuit est alors composé de citations placées entre guillemets, tirées de propos entendus et notés au long d’une existence d’avocate tissue d’activités nombreuses et variées.
Le stage que l’École du Barreau prévoit pour ses diplômés s’est principalement passé dans son cas au Village-Huron de Lorette, dans les bureaux de l’Association des Indiens du Québec. Déterminant, ce stage a amené l’avocate à s’occuper des droits des Autochtones « pendant plus de trente ans », surtout comme conseillère juridique, auprès de communautés amérindiennes du Québec, du Canada et même de l’étranger, ainsi qu’en témoigne sa participation au Tribunal Russell, à Rotterdam, en 1980. En plus de faire état des différentes facettes de son travail professionnel, Renée Dupuis raconte son passé de mère (deux naissances et deux fausses couches), d’épouse (de l’écrivain Pierre Morency), d’auteure (de cinq livres), de chargée de cours (à l’ENAP), de présidente ou vice-présidente (d’organismes, de commissions, d’audiences publiques, de panel), de sénatrice (indépendante), de bénévole (à Relevailles), de conceptrice (des structures juridiques de l’UNEQ et du Fonds Gabrielle-Roy), d’intervieweuse (à Radio-Canada)…
De ce récit à multiples volets se dégage nettement la combattante des droits de la personne – non seulement des Autochtones, mais en particulier des femmes –, affichant un féminisme concret. Renée Dupuis déplore « l’hypocrisie sociale autour de la sexualité, dont seules les femmes subiss[ent] les dommages collatéraux ». Elle constate qu’« une femme avocate dérange beaucoup d’hommes ». Elle voit la résistance « des collègues européens, français en particulier, devant la féminisation des titres ». Elle se souvient également du « harcèlement sexuel » d’un confrère avocat, de l’« attitude profondément sexiste » d’un autre, de l’« attaque » verbale agressive d’un professeur de l’ENAP… Femme aux opinions claires et au discours direct, elle se rappelle le « monologue injurieux » d’un haut fonctionnaire québécois qu’elle a « interrompu [au téléphone] en haussant la voix d’au moins deux tons avant de raccroch[er] ». « Je prépare, dit-elle, le chemin de femmes qui me suivront dans la marche vers l’égalité pour les femmes », ajoutant plus loin : « [l]es femmes doivent continuer de se considérer comme égales aux hommes, même si c’est aller à contre-courant de l’image que l’on a d’elles ».
Renée Dupuis n’est souvent pas tendre envers les gouvernements d’Ottawa et de Québec : elle dénonce l’attitude du fédéral lors de la relocalisation de familles innues dans les années 1960, sa non-adoption, encore à ce jour, d’une loi encadrant la pratique de l’avortement, « l’ignorance profonde […] de la part des deux gouvernements » des communautés autochtones ainsi que de leur organisation sociale et politique, le « système scolaire […] lacunaire » au Québec et au Canada concernant la question autochtone ou, encore, la « discrimination inscrite dans le système d’embauche des milieux de travail » au Québec…
Dans l’ensemble, l’auteure de Ce chemin sous mes pas laisse d’elle-même, on ne s’en étonne pas, une image toute positive qui ravira sa progéniture. Les compliments des uns (« vous êtes vaillante », « vous êtes intemporelle »), les appréciations des autres (« votre beau travail », « votre engagement continu », « vous nous avez toujours soutenus »), de même que sa propre appréciation personnelle (« J’étais écoutée et cela se savait », « mon travail acharné », l’« impartialité de mon rapport d’enquête ») donnent au récit le caractère d’un tombeau.