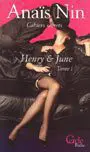Voici donc les pages censurées (octobre 1931 à octobre 1932) du célèbre journal de la petite et sauvage Anaïs-Carmen, battue par son père, qu’on peut aussi voir comme une petite Marcelle, femme de banquier hantée par l’inceste. Henry Miller et June Mansfield, personnages dostoïevskiens, joueurs invétérés à la roulette de la vie, s’arrachent la peau. June, « la plus belle femme de la terre », semi-prostituée, irresponsable, pauvre, amorale, terrorisée par l’existence, guidée par la seule logique de la folie, figure l’un des sommets de cet improbable triangle. Au fait, le polygone ne possède-t-il pas bien davantage que trois côtés ? Déjà Anaïs, en bonne hystérique, aime et trompe tous les hommes avec d’autant plus de panache qu’elle a le don de l’humiliation et de l’adoration. Son idéalisation du génie littéraire de Henry Miller se confond avec l’amour de l’homme, de son corps et de sa puissance chancelante. « Il devance même Joyce », va-t-elle jusqu’à écrire, pointant par là le délaissement de tous les genres. Et au fond, pourquoi pas ? Le grand Irlandais ne fut pas le dernier écrivain. Reste qu’Anaïs oscille comme June entre la joie la plus pure et la cruauté la plus dure à l’égard de Miller, craintif, doux, vulnérable et cynique. À l’égard de June, Anaïs est toutefois le plus souvent maternante, contenant la mort tel un cercueil de chair, acceptant tout de sa destructivité, y compris sa haine froide.
On comprend qu’elle cherche à loger chez René Allendy ses questions. Contrairement à ce qu’on a pu bêtement écrire, cette analyse (il y en aura une seconde, chez Otto Rank) ne se résume pas à l’éclairage d’un banal complexe d’Œdipe, il met plutôt en question le mi-dire de la vérité : « Devant une lettre ou devant mon journal, j’ai le désir d’être honnête, mais peut-être qu’au bout du compte je suis la plus grande menteuse de tous, plus que June, plus qu’Albertine, à cause de cette apparence de sincérité ». Mensonge et vérité se confondent alors dans la tragédie burlesque des échanges amoureux. Des pages parfois étonnantes générées par son analyse, on voit se dégager durant cette période d’intense découverte sexuelle une logique sadomasochiste arrimée à des nouages articulant la frigidité partielle et l’angoisse d’avoir un enfant, la pathologie de la création, la masturbation ainsi que la honte et la culpabilité, sans compter le vacillement du choix d’objet d’amour, Allendy devenant le support des identifications masculines qui vont se multipliant. Nous sommes bien dans le registre de la jouissance perverse : « Avec un visage de madone, j’avale toujours Dieu et le sperme et mon orgasme ressemble à la grâce du mystique ». Et cette jouissance, c’est bien celle du journal, qui devient un « vice », une « maladie », la crypte d’un narcissisme et d’un désir de servitude lesquels, même sublimés, continuent bien sûr d’agir à travers la discipline de l’écriture quotidienne.